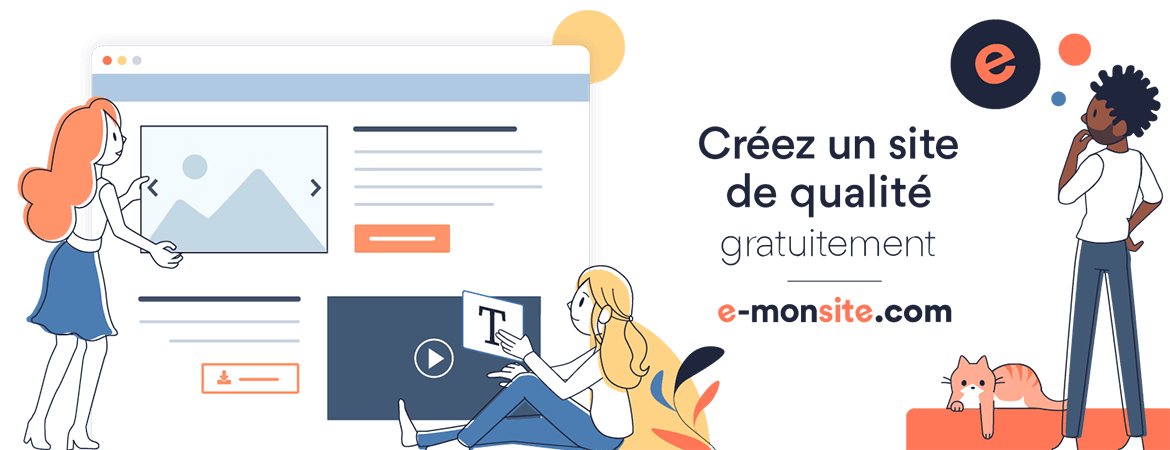- Accueil
- HISTOIRE DES IDEES
- Rueff
- Rueff et ordre social - 2ème partie
Rueff et ordre social - 2ème partie
2. Le droit de propriété, vecteur de normes contradictoires ?
En consacrant l'essentiel de ses réflexions aux questions monétaires et aux politiques économiques qui leurs sont associées, J. Rueff renforce une lecture en termes de vrais droits. Si une telle démarche justifie son inscription dans la problématique des droits de propriété, elle risque d'en rendre l'apport contrasté, au vu de ce que nous avons analysé précédemment. Aussi allons nous voir d'abord qu'elle est l'essence de la politique monétaire pour J. Rueff. Il semble bien qu'elle soit le vecteur d'exigences difficilement conciliables. Elle oblige à mettre en lumière une théorie implicite des institutions. Celle-ci repose sur deux dimensions essentielles : une relation à la méthodologie et une articulation entre ce que nous pouvons appeler les contraintes formelles et informelles. Ceci nous conduira à aborder ensuite la conception rueffienne des institutions. J. Rueff semblera proche de l'idée selon laquelle l'« ordre social a la dimension d'un bien collectif » et que « personne ne peut espérer que les individus et les groupes le mettront d'eux-mêmes en œuvre », (J.-D. Lafay, 1991, p. 12). Aussi pour faire fasse aux pressions possibles émanant de la sphère privée vers la sphère politique notre auteur préconise t-il, en conclusion de L'Ordre social, la mise en place de règles constitutionnelles. En insistant sur des règles formelles comme condition de défense des droits de propriété, J. Rueff corrobore l'idée de manipulation politique des droits via la monnaie mais aussi l'idée du caractère néfaste des idées (de l'idéologie) pourtant apparues comme ciment de toute société.
2. 1. Vrais droits et théorie des prix.
Pour montrer l'éventuelle discordance au cœur du schéma rueffien, nous allons nous appuyer sur la critique d'Y. Crozet (1994, 2000). Pour ce dernier, le droit de propriété est vecteur de certains comportements, notamment la soumission à la flexibilité des prix. Cela est particulièrement vrai pour le marché du travail qu'analyse J. Rueff dans le contexte de crise des années 30 en Grande-Bretagne . J. Rueff établit une relation univoque entre le taux de chômage et le niveau du salaire réel, qui sera d'ailleurs appelée la « loi de Rueff ». C'est le maintien des salaires nominaux qui empêche la baisse du salaire réel nécessaire en période de déflation. Une telle flexibilité des salaires (du prix du travail) apparaît alors, selon Y. Crozet, difficilement compatible avec le comportement des salariés, notamment en période de déflation. Le problème tient pour l'auteur dans les degrés différents de flexibilité des prix sur les marchés.
« De même que la hausse généralisée des prix révèle la mise en circulation de faux droits, de même la baisse crée une incertitude sur le niveau réel des revenus futurs, ce qui suscite rapidement un comportement d'attentisme généralisé dans une économie où la monnaie est fondée sur le crédit, et donc sur les capacités de remboursement des débiteurs. Car la flexibilité n'est pas généralisée. Même si les salariés étaient loyaux, parce que bien informés sur l'illusion monétaire, en d'autres termes, même s'ils anticipaient une baisse des prix du même ordre de grandeur que la baisse des salaires nominaux ; il reste que les remboursements d'emprunts eux ne baissent pas (intérêt généralement et principal sûrement). Quelque part, la déflation remet donc en cause les droits de propriété et place les banques dans une situation exorbitante, tellement exorbitante que les débiteurs font défauts et que la faillite financière accompagne la déflation », (Y. Crozet, 2000, p. 643).
Faut-il croire que J. Rueff raisonnerait au moins en certains endroits dans un cadre d'analyse partiel ? Les interprétations sont plutôt partagées sur ce point précis . Il est certain en tout cas que l'analyse du marché du travail, au vue des conclusions qu'en tire J. Rueff, reste, comme le souligne J. P. Fitoussi (1987), « partiel et partial ». Le tort de J. Rueff serait d'imputer aux seules allocations chômage le maintien à un niveau élevé des salaires réels par une réduction de l'offre de travail . Au-delà du fait de savoir quel est le positionnement final de J. Rueff, il faut souligner que le cadre d'analyse utilisé jouit d'une grande importance dans la perception du droit de propriété. D'ailleurs pour J. Rueff, il conviendra lors des réformes de compenser les perdants, ce qui traduit une sensibilité pour les schémas globaux plutôt que partiels.
Plus largement, le fait que les agents et notamment les salariés doivent se soumettre à la discipline marchande est symptomatique pour Y. Crozet (1994, p. 159) d'une « longue tradition libérale » qui recherche « par la voie indirecte du levier monétaire, une adaptation des structures sociales propres à rendre l'économie nationale plus efficiente ». Fondamentalement la tension liée aux exigences difficilement compatibles traduit, selon Y. Crozet une situation manifeste d'anomie au sens de Merton, puisque le but est hors d'atteinte avec les moyens disponibles. Un tel point de vue est déjà avancé par J.-P. Fitoussi (1987, p. 865) qui l'illustre plus particulièrement au sujet du chômage anglais des années 20-30. « Et en effet, faut-il bouleverser la société pour atteindre un objectif que l'on pourrait atteindre par d'autres moyens ? Si la rigidité des salaires nominaux est le signe d'un équilibre social (toujours fragile), faut-il détruire cet équilibre faute d'admettre que la monnaie est surévaluée ? ». La thèse de l'anomie est tout cas lourde de conséquence puisqu'elle signifie l'incohérence de l'ordre social rueffien.
« Dans son modèle d'ordre social les individus écartent et le recours à la protestation et la démission (...) De même que la méritocratie serait, si elle s'appliquait intégralement, déprimante, de même la vertu libérale ne peut à l'évidence constituer le seul repère de la vie sociale », (Y. Crozet, 1994, pp. 162-63).
L'un des arguments proposés par Y. Crozet consiste à dire que les individus n'ont pas forcément intérêt à être vertueux selon une logique économique.
« Une telle interrogation n'est pas à priori subversive, elle dérive tout simplement de l'hypothèse méthodologique qui fonde le libéralisme : les décisions des individus sont à la base des phénomènes collectifs, et lesdits individus définissent leurs comportements à partir d'une comparaison permanente des coûts et des avantages relatifs des options qui s'offrent à eux. Comme les autres attitudes, la vertu est donc soumise à un arbitrage », (Y. Crozet, 1994, p. 161).
En ce sens l'endogénéisation du comportement aboutit à une remise en cause du schéma rueffien. Mais n'est-ce pas précisément la raison fondamentale qui permettrait de justifier le recours au sens moral chez J. Rueff ? Ce comportement ne doit faire l'objet d'aucun arbitrage.
Nous devons constater pour le moment que le jugement critique porté à l'égard du schéma rueffien est peut-être hâtif. Nous pouvons nous fonder pour le montrer sur « Le discours sur le crédit » déjà évoqué précédemment. Il semble bien que ce texte nourrisse une interprétation différente de J. Rueff. En rendant le système bancaire responsable de l'inflation, notre auteur dédouane mécaniquement l'Etat de cette faute. Il apparaît alors que la référence au libéralisme (du moins à une certaine définition du libéralisme) constitue l'axe de réflexion. Comme le souligne D. Bevant (1993, p. 496), même si J. Rueff peut être considéré comme un « classique pré-keynésien », ne faut-il pas rappeler que son « classicisme » est « raisonnablement tempéré par des considérations sociales permanentes » ? La conclusion de D. Bevant tranche alors avec celle d'Y. Crozet. « L'ordre social de Jacques Rueff ne paie pas la stabilité monétaire du prix d'un chômage persistant ». D'ailleurs la politique du salaire minimum (SMIG) défendue par J. Rueff justifie une telle interprétation. En effet l'idée de salaire minimum est à priori incompatible avec l'exigence de flexibilité, à l'inverse de la limitation de la durée du temps de travail. Or, dans le Rapport sur les obstacles à l'expansion économique, J. Rueff (et alii. , 1960) maintient le SMIG, sous prétexte qu'il « protège les titulaires des salaires les plus bas contre les conséquences douloureuses que pourrait entraîner, pour eux, une hausse du coût de la vie », (J. Rueff, 1960b, p. 411). Il existe ainsi une friction entre la théorie et les exigences que nous pouvons qualifier d'institutionnelles. Le droit de propriété porte évidemment cette tension puisqu'il se situe à la croisée des perspectives : habitudes de comportement et exigences à respecter. C'est dans ces conditions l'ordre social fondé sur la flexibilité des prix-induite par la définition des vrais droits-qui est en jeu. Existe-t-il toutefois une explication interne au schéma rueffien comme le suggère D. Bevant ? Le problème tient dans l'origine des faux droits que J. Rueff ramène bien souvent à une cause financière et notamment au déficit budgétaire. Cette question a été évoquée précédemment avec le genèse des faux droits. Il existe en effet d'autres sources inflationnistes. Ainsi l'analyse proposée par J. Le Bourva (1959) de la conjoncture des années 50 révèle qu'une explication moniste en terme de déficit est insuffisante. Si cet auteur défend plutôt une conception keynésienne fondée sur les anticipations des entrepreneurs comme mobile de l'activité, il note la singularité (pertinente) de J. Rueff concernant la fixation de la quantité de monnaie. Rappelons en effet que pour J. Rueff, la monnaie dépend des préférences du public. Mais dans ce cas selon J. Le Bourva, rien n'empêche une inflation endogène liée par exemple à des anticipations favorables des entrepreneurs et des banques. En ce sens, la théorie des droits de propriété de J. Rueff appelle une théorie des cycles qu'il n'envisage pas.
La notion de vrai droit paraît donc instable et peut renvoyer, dans le cadre d'une problématique d'ordre social, à plusieurs contenus. Une telle éventualité nous semble renforcée par les vertus supposées des prix concurrentiels. Comme nous l'indiquions précédemment, J. Rueff fait confiance au marché, moins par raisonnement (démonstration) que par expérience. D'une certaine manière il est vrai que la fixation autoritaire des prix conduit à des comportements et des phénomènes types, comme la "course aux biens" ou les queues devant les magasins. Mais reste le problème crucial de la flexibilité des prix. Sans doute existe t-il des raisons de demeurer pessimiste sur cette question . Sans aller dans cette direction qui nous éloignerait de notre propos, il est possible de nous appuyer sur certaines réflexions, plus tardives, de J. Rueff notamment dans le Rapport sur les obstacles à l'expansion économique. Dans un premier temps, J. Rueff reprend une argumentation classique. « La véracité des prix est, dans une économie de décisions largement décentralisées comme la nôtre, la condition nécessaire d'un comportement des individus et des entreprises assurant l'élimination des gaspillages de ressources », (J. Rueff, 1960b, p. 348). Aucune démonstration n'est opérée, ce qui peut encore se justifier par le contexte d'écriture du Rapport où seule la philosophie économique générale est présentée pour justifier des mesures plus concrètes et donc plus politiques. Toutefois, même à ce niveau de présentation, un certain raffinement est opéré, conduisant à un résultat particulièrement intéressant.
« Sans doute ne faut-il pas sous-estimer les difficultés de la tâche. La notion de coût est complexe et incertaine ; il est cependant possible de déterminer des ordres de grandeur raisonnables, surtout lorsqu'on dispose des éléments d'information que peuvent fournir avec le progrès des systèmes de comptabilité, les grandes entreprises industrielles et commerciales », (p. 348).
Si l'appel à des grandeurs raisonnables ici n'a rien à voir avec la notion de valeur raisonnable chez J. R. Commons, le rôle des prix apparaît nettement compromis et atténue mécaniquement la défense d'un droit de propriété fondé sur la flexibilité des prix. Aussi convient-il d'« éclairer le marché » (p. 404) par un dispositif approprié qu'il incombe aux pouvoirs publics de mettre en place, c'est-à-dire « pour permettre une meilleure connaissance des coûts et des qualités des produits offerts, notamment pour les fruits et légumes et les viandes : normalisation, répression des fraudes, réseau de télécommunication, d'aider au « regroupements représentatifs » de consommateurs, etc. ». Ces raisons ne militent-elles pas une fois encore en faveur d'un J. Rueff « classique tempéré » ? Les conséquences quant à la définition du droit de propriété en paraissent en tout cas importantes mais J. Rueff ne les aborde jamais. Si l'application du droit de propriété suppose certaines conditions sociales, c'est la lecture du modèle de marché qui risque de s'en trouver modifié. C'est ce que nous allons envisager désormais en nous fondant sur une exigence méthodologique de J. Rueff, le test des théories comme critère de validation de ces dernières. De ce fait des théories pertinentes à un moment donné-dont la théorie libérale fondée sur l'autorégulation des marchés-peuvent ne plus s'appliquer à un autre moment. Que va devenir dans ces conditions une approche fondée sur le vrai droit de propriété ?
2. 2. Droit de propriété et monnaie institutionnelle.
Si la défense des vrais droits paraît contraignante, nous pouvons nous demander si la majorité de l'opinion sera prête à l'accepter. Pourquoi se plier en effet à un idéal qui n'est pas souhaité ? Pourquoi, plus largement, adhérer à l'ordre marchand, si ce n'est pour admettre que le marché est le meilleur mécanisme d'allocation des ressources ? Ces questions se posent d'autant plus que J. Rueff reconnaît la nature instable de la vérité scientifique, donc de la réversibilité des théories contraires, comme peuvent l'être par exemple et de manière un peu caricaturale, le libéralisme et le keynésianisme.
L'idée de relativité des théories économiques, centrale pour notre propos, ressort du premier essai de J. Rueff, Des sciences physiques aux sciences morales publié en 1922. Cet essai est d'autant plus important que J. Rueff déclare ne pas avoir changé de point de vue lors de la réédition de 1969. Notre auteur défend dans cet ouvrage les principes d'unité méthodologique et de relativisme de la science. « Une théorie n'est pas vraie, absolument par essence ; elle est plus ou moins vraie selon l'époque, l'ensemble du système qui constitue la science théorique du moment, selon les individus, leurs conditions de vie, et l'ensemble de leurs aspirations », (J. Rueff, 1922, p. 126). On saisit aisément pourquoi, dans l'esprit de J. Rueff, ce n'est pas une relation particulière en face de certains faits qui justifierait un choix de méthode. La distinction consacrée entre compréhension et explication issue de la "méthodenstreit" apparaîtrait dénouée de signification ici puisque tous les faits, humains et naturels, restent inaccessibles dans leur essence . C'est pour cette raison que J. Rueff distingue les théories euclidiennes (qui sont vérifiées par des tests) des théories non-euclidiennes (qui ne s'appliquent pas à la réalité du moment). Il n'y a pas dans ce cas d'idéal à poursuivre, puisque tout est scientifiquement relatif. « Tout ce que nous pouvons affirmer, c'est que l'état de notre univers est parfaitement déterminé à chaque instant et ceci suffit à fixer, à chaque instant également, les lois qui constituent la science empirique du moment », (J. Rueff, 1922, p. 116). C'est pour cette raison que l'expérience est le mode de révélation de l'autorégulation des mécanismes marchands . Ainsi lorsque J. Rueff utilise la notion de « géométrie morale », ce n'est pas dans le sens d'une théorie morale universelle. Elle représente une simple systématisation des pratiques sociales. Il n'y a pas pour J. Rueff d'explication universelle valable en tout temps et en tout lieu, ni d'idéal à atteindre. Ainsi il n'est pas sûr, étant donnée la relativité des théories, que la pratique libérale soit effectivement celle défendue par les acteurs économiques. D'ailleurs pour J. Rueff l'économie politique "marxiste " peut devenir réalité c'est-à-dire expliquer la réalité si la production et la répartition sont organisées comme « le demandent les collectivistes ».
« On dit souvent que le socialisme ou l'interventionnisme excessif violent les lois économiques. C'est là une expression inexacte. La réalisation de ces régimes, différents du nôtre, ferait que certaines lois qui régissent actuellement les phénomènes ne joueraient plus, les conditions qu'elle prévoient n'étant plus réalisées », (J. Rueff, 1922, p. 174).
La conception rueffienne des critères de scientificité permet de jeter un regard nouveau sur la notion de vrai droit de propriété. Soit cette notion est irrémédiablement liée au comportement marchand et donc risque de ne pas être universelle. Soit il est possible d'atteindre un régime de vrais droits en modelant les comportements (notamment à travers l'éducation), ce qui revient à accepter une forme d'idéal pourtant récusé par l'auteur. En insistant sur le rôle de l'éducation, J. Rueff semble conforter cette seconde piste. Une telle éventualité ressort d'un débat portant sur la rénovation du libéralisme, où participe J. Rueff. Ce dernier répond, au cours de ce débat, à l'un des interlocuteurs soutenant la nature impraticable du libéralisme à cause de son manque de soutien.
« Il n'y a pas à l'heure actuelle de forces sociales qui poussent dans le sens du libéralisme : ni les forces ouvrières ni les forces patronales (...) S'il faut qu'ils s'élèvent à une philosophie sociale, qu'ils expliquent l'ensemble du mécanisme, je crains qu'ils ne réussissent pas à imposer à leur milieu les vues dont ils se réclameraient à ce moment », (J. Rueff, 1939, p. 466).
J. Rueff rétorque alors :
« Pour faire une politique consciente, on doit faire porter tout l'effort sur l'amélioration du bien-être des individus. Et sur ce point je souhaiterais beaucoup avoir une discussion autour de la table avec des représentants du monde ouvrier : ce sont les interlocuteurs les plus utiles, car à mon avis le seul débat qui existe entre eux et nous repose sur les moyens et non sur les fins », (J. Rueff, 1939, p. 470).
Nous sommes bien en présence dans cet échange verbal des deux phases de l'argumentation repérées dans notre discussion précédente. D'un côté la nécessité d'appuyer une politique-qui s'inspire d'une théorie normalement euclidienne-sur une pratique préalable qui la valide. De l'autre côté la possibilité de modifier la réception des politiques afin d'en rendre l'application possible et générale.
Le niveau dual de raisonnement permet par ailleurs de soulever une autre tension dans le raisonnement liée à la méthode d'action libérale. Dans la critique déjà évoquée d'Y. Crozet (2000), ce dernier prétend notamment que J. Rueff défend une conception trop rigide des droits de propriété. Il s'agit désormais d'imposer un idéal formulé dogmatiquement par la science. N'est-ce pas alors contradictoire avec un raisonnement plutôt fondé sur l'analyse patiente des faits et la tentative à posteriori de systématisation ? Nous pouvons nous reporter à la critique rueffienne de J.-M. Keynes pour l'illustrer. D'après J. Rueff, si J.-M. Keynes défend l'hypothèse d'une monnaie nominaliste, alors sa théorie est valide. Or c'est précisément ce que fait l'économiste anglais dans la Théorie générale de l'intérêt et de l'emploi. Cet argument est fondamental car il conduit à remettre en cause l'opposition J.-M. Keynes-J. Rueff et à porter le débat sur les questions méthodologiques et non plus spécifiquement monétaires . S'agit-il ici d'une histoire de test ? La question se pose en effet puisque lorsque J. Rueff prétend que la théorie keynesienne est euclidienne dans un monde de rigidités, c'est la référence à la réalité qui domine. Mais il convient alors de positionner le véritable problème : s'agit-il de déterminer la vrai théorie ou la meilleure ? Ce point nous paraît d'autant plus important qu'il débouche sur le statut des institutions. Après tout l'existence de syndicats peut aussi manifester une certaine réalité institutionnelle garante de la stabilité de l'ordre social. C'est précisément sur ce point qu'Y. Crozet s'en prend au schéma rueffien. Nous voyons alors que la définition rueffienne des institutions, et notamment des vrais droits, est particulière. Elle ne fait pas, ou pas uniquement, référence à des pratiques réelles mais à des pratiques hypothétiques. Il semble alors que J. Rueff défend un idéal auquel devraient se soumettre les individus. En ce sens il y aurait effectivement contradiction dans l'analyse entre deux exigences renvoyant à deux conceptions spécifiques des institutions. D'un côté la théorie, au moins dans ses applications pratiques, doit prendre en compte les préférences et les comportements actuels des agents. De l'autre les institutions doivent se plier aux exigences de la théorie.
Dans la mesure où la défense du droit de propriété implique certains comportements qui ne sont pas donnés, J. Rueff va envisager, même s'il ne fait pas directement la relation, un ensemble d'institutions (contraintes) permettant d'atteindre la fin souhaitée. C'est sans doute pour cette raison qu'il est amené à évoquer l'idée de monnaie institutionnelle. La réforme monétaire est, selon lui, le meilleur moyen d'associer des exigences contradictoires.
« En l'état actuel des choses, dans notre pays, tels qu'ils sont, les hommes ne se laissent pas aisément conduire par les équations. Ils résistent et il est difficile de les empêcher de résister, si l'on n'accepte pas de leur couper la tête trop souvent. La méthode monétaire, au contraire, n'implique ni calculs complexes, ni théories subtiles. Elle est à l'échelle humaine, et c'est pour cette raison que, pour moi, le monde ne sortira, s'il sort jamais de l'âge de l'inflation, que par le retour généralisé aux techniques monétaires », (J. Rueff, 1956a, p. 45, nous soulignons).
Reste à voir ensuite si la méthode monétaire ne renvoie pas à ce que Y. Crozet (1994) qualifie de « société déflationniste » avec les tensions afférentes. C'est la prise en compte des institutions et de la nécessité de réformer "en douceur" qui conduit selon nous J. Rueff à parler du « problème institutionnel de la monnaie ». Un des éléments qui définit cette question concerne en effet les préférences collectives. Au sujet de ces dernières, J. Rueff adopte un double point de vue. Dans l'article de 1953, consacré à la nature institutionnelle de la monnaie, il évoque l'« opinion publique ». Pour J. Rueff, la régulation monétaire, c'est-à-dire l'ajustement automatique de l'équilibre n'est possible que dans un cadre préétabli. C'est en ce sens qu'il est fait référence à des variables à la fois politique et psychologique : « administration appropriée », « organisation plus ou moins consciente des systèmes monétaires », les exigence de l'opinion («l'opinion exige »), l'« état de la conscience sociale ». Une telle approche, si elle permet d'enrichir une analyse purement théorique de la régulation monétaire, interroge de toute évidence la validité scientifique du concept d'opinion publique et notamment sa genèse (Sondages ? Intuition des hommes politiques ?, etc. ). Au niveau des institutions cette référence de J. Rueff indique qu'il faut suivre l'opinion. Donc les institutions reflètent ou doivent s'efforcer de refléter les idées des individus. Mais la question de l'émergence et de la représentation de ces préférences est évacuée par J. Rueff dans la mesure où il se donne les individus qu'il entend convaincre. « Actuellement, la grande majorité de l'opinion exige, avant tout, d'un système monétaire, qu'il ne fasse pas obstacle au développement de la production, et par là assure le « plein emploi » des facultés productrices, mais elle souhaite en même temps que le système choisi donne au niveau général des prix toute la stabilité compatible avec la fin précédente » (J. Rueff, 1953a, p. 181). J. Rueff semble en tout cas évoluer sur la question de l'agrégation des préférences puisque dans un article antérieur de 1932, « Défense et illustration de l'étalon-or », il adopte une position plus nuancée en terme d'intérêts convergents pour...la destruction du mécanisme de marché. « Depuis dix ans, tout l'effort des hommes a tendu à construire le monde, non tel qu'il devait être pour durer, mais tel que ceux qui y vivaient voulaient qu'il fût pour qu'il leur donne le maximum de satisfaction contre le minimum de peine », (J. Rueff, 1932, p. 61). L'exemple du Trésor est pour J. Rueff révélateur puisque les forces sociales sont contradictoires. Les contribuables souhaitent payer le moins d'impôt possible, les fonctionnaires obtenir des salaires plus élevés, les utilisateurs de services publics des prix bas, etc.
D'une manière générale pour J. Rueff, c'est l'inflation, alimentée par la demande sociale qui est responsable de l'instabilité. « Bien plus que l'idéologie marxiste, l'inflation engendre l'esprit de classe. Par le sentiment de frustration qu'elle suscite dans la plus large partie de la population, celle qui eût du être mieux protégée, elle fait naître la volonté de subversion sociale et de révolution », (J. Rueff, 1952, p. 82). Par rapport à la logique institutionnelle, nous comprenons désormais pourquoi un compromis politique doit être trouvé . Pour J. Rueff, ce compromis ne peut reposer que sur la stabilité monétaire. De surcroît, la réussite du changement institutionnel, mené par les élites, tient dans la gradation et la compensation financière, « jusqu'à la limite qui est humainement acceptable et politiquement possible », (J. Rueff, 1961b, p. 487). Bien que J. Rueff semble prendre en compte les habitudes et les préférences des individus dans la conduite de la politique économique, une telle attitude demeure difficilement compatible avec la notion de vrai droit lorsque ces habitudes conduisent à certaines rigidités. Il apparaît en tout cas que la généralisation des vrais droits suppose un certain climat intellectuel.
Nous observons, à l'issue de cette discussion, que J. Rueff hésite entre deux conceptions des institutions. L'une qui serait normative, fondée sur les vrais droits mais devant s'accompagner d'institutions d'encadrement. Une autre qui partirait des préférences de la collectivité. Toutefois en se donnant dans ce dernier cas les individus à convaincre, J. Rueff homogénéise implicitement ces deux conceptions potentielles . Le problème n'est plus tant une question de fins que de moyens. Toutefois pour atteindre la fin désirée, J. Rueff va osciller entre deux voies. La première repose sur l'éducation des masses et s'appuie sur l'importance des mentalités, la seconde fait appel à l'institution de règles intangibles émises au niveau constitutionnel.
2. 3. De l'éducation aux règles constitutionnelles.
Nous avons vu que l'ordre social que J. Rueff finit par qualifier de moral implique l'existence d'autorités politiques. La mise en œuvre des fins collectives implique d'une manière ou d'une autre une « dépossession » du droit de propriété des individus pour le transférer à l'Etat . Il existe à partir de là deux moyens d'amener les individus au comportement désiré par les autorités publiques, le commandement et l'incitation. Si la première est autoritaire, la seconde est incitative (J. Rueff dira aussi libérale) . L'intérêt de la distinction tient dans les pratiques institutionnelles qu'elles supposent. Ainsi en ce qui concerne le coût des interventions, J. Rueff souligne qu'il est plus élevé avec les méthodes autoritaires.
La distinction entre les deux méthodes suggère que le droit de propriété est affecté de manière différente mais que le résultat reste comparable, au moins en terme économique.
« Toutefois l'opposition est plus apparente que réelle. En régime libéral, le propriétaire obtient de son domaine le rendement maximum, mais seulement après que ce domaine a été amputé de la fraction nécessaire au financement de l'action gouvernementale. En régime autoritaire, le propriétaire conserve l'intégralité de son domaine mais voit réduire, par la contrainte gouvernementale, la désirabilité totale des services qu'il peut en extraire. Nous avons montré que, dans les deux cas, la valeur du prélèvement était la même, qu'elle ne dépendait que de l'intervention accomplie, non de la méthode par laquelle elle l'était », (J. Rueff, 1945, p. 667) .
D'ailleurs quelle que soit la méthode, les sociétés peuvent être à vrais droits. Il faut croire en fait que les régimes autoritaires, par le rôle déterminant qu'y joue l'Etat, sont davantage susceptibles de générer des faux droits. N'est-ce pas une façon de dire que le politique est neutre sur l'économique, ou du moins qu'il existe à ce niveau un grand degré de liberté ? En ce sens il existerait une autonomie relative du politique. Cette dernière est d'ailleurs conforme à la conception rueffienne de l'inflation comme cause du déficit public. Une fois les dépenses engagées se met en place un circuit endogène d'intervention croissante de l'Etat menant à la planification. Pour soulager les souffrances issues de l'inflation, l'Etat intervient en effet davantage dans l'économie en administrant un certain nombre de prix. Une telle action entretient alors l'existence de faux droits. Mais dans ce schéma, les raisons du déficit ne sont pas endogénéisées. Nous ne savons pas pourquoi, à un moment donné, un gouvernement choisi l'inflation plutôt qu'une méthode non inflationniste, qu'elle soit autoritaire ou libérale.
Si J. Rueff réfléchit à l'articulation entre deux types de méthode de gouvernement (deux types de dépossession du droit de propriété), il semble qu'un troisième élément intervienne, liée au rôle des mentalités et plus largement des idées. L'exemple de la Défense nationale permet de l'illustrer. Les deux méthodes décrites par J. Rueff se déclinent alors, pour la méthode autoritaire, en conscription, et pour la méthode libérale, en armée de métier . Parallèlement à ces deux dimensions, J. Rueff en développe une troisième qu'il considère comme l'« un des problèmes fondamentaux qui se posent à notre pays », et qui concerne la « profonde incertitude à l'égard des idéaux susceptibles d'inspirer un pays », (J. Rueff, 1955b, p. 261) . L'esprit civique peut alors s'interpréter en termes de réduction du coût économique de l'action gouvernementale (fondée sur l'incitation ou le commandement).
« Si un individu sent très fort dans son cœur une profonde dévotion à l'Etat, s'il a un sentiment patriotique très intense, il ne sera pas difficile de lui faire consentir les actes qu'on attend de lui sur le champs de bataille. Si au contraire, il n'a dans son cœur aucun désir de les accomplir, il faudra, pour les lui faire accomplir, un énorme effort institutionnel, de commandement ou d'incitation, et il en résultera une « tension » qui sera d'autant plus grande que l'individu était plus éloigné de la volonté d'accomplir l'acte attendu de lui », (p. 260).
Cet extrait fait bien ressortir les trois dimensions de la politique en matière de défense nationale et plus largement en matière institutionnelle. Appliquée à la théorie du droit de propriété, cela indique que le vrai droit suppose l'absence de tension avec les comportements marchands prescrits.
Le rôle de l'idéal animant la collectivité (constituant un gain d'application des contraintes) va conduire J. Rueff à mettre en avant dans l'ouvrage de 1967, Les Dieux et les rois, le rôle de l'idéologie comme vecteur de comportements. « L'existence en chaque époque, dans tout groupe social, d'une idéologie dominante affecte et coordonne la grande majorité des comportements individuels. C'est par cette conséquence que les idéologies constituent le principal ciment des sociétés humaines », (J. Rueff, 1967, p. 187). L'importance de l'idéologie est liée, pensons-nous, à celle du conditionnement de la nature humaine indiquant qu'il n'y a pas de préférences immuables d'un côté et un système de contraintes de l'autre. L'idéologie joue ainsi un rôle essentiel de reconditionnement et de stabilité des sociétés. J. Rueff met aussi en avant l'idée que les mécanismes d'incitation ne peuvent jouer qu'avec des individus déjà normés. Il n'en tire toutefois aucune conséquence en ce qui concerne la régulation marchande, c'est-à-dire l'acceptation par les individus des règles du marché. « Si la sanction contraignante est convenablement calculée et toujours appliquée, elle donne à l'autorité dont elle émane la certitude de pouvoir fixer à son gré, en toutes circonstances, les comportements de tous les individus non anormaux. Seuls échappent à son action contraignante les pécheurs invétérés, chez qui l'attrait du péché l'emporte sur la crainte des sanctions dont il est assorti, ou les individus dont l'intelligence est trop obtuse pour qu'elle puisse rapprocher une sanction future d'une satisfaction immédiate », (J. Rueff, 1967, p. 202) . Un problème lié à l'origine des comportements se pose toutefois dans la mesure où cet accord sur les règles repose sur l'intervention des hommes qui agissent ainsi sur les consciences : « la mutation prométhéenne a transformé l'influence associative. En faisant du psychisme la source des comportements conscients, elle a confié à des « idéologies » appuyées de « contraintes » la coordination des activités individuelles », (p. 223). Et J. Rueff reconnaît la « singulière puissance » dont doivent être alors pourvus l'idéologie et le systèmes de contraintes pour orienter le comportement d'individus encore largement instinctifs. « C'est l'adoration de l'ancêtre commun, sentiment très proche, sans doute, des attirances biologiques, à mi-chemin en tout cas entre la biologie et la psychologie, qui a fourni le ciment de toutes les sociétés primitives », (p. 223). J. Rueff ne défend pas l'idée que tous les individus partagent les mêmes croyances ou la même foi mais seulement que ceux qui appliquent les sanctions sont entièrement fidèles à l'idéologie régnante. Nous sentons dans ce cas l'idée de corruption des élites qui menace l'ordre social. C'est en fait la question du contrôle de ceux qui contrôlent qui est posé. Ainsi nous devons penser que les règles marchandes et leur acceptation s'inscrit dans l'idéologie dominante.
La nécessité d'éduquer les individus se fait particulièrement sentir au moment des réformes conduisant à davantage de flexibilité. Le Rapport sur les obstacles à l'expansion économique, déjà évoqué et qui traite tout particulièrement des réformes à accomplir, traite naturellement des résistances du corps social. « Le Comité a également constaté que les obstacles à l'expansion sont d'importance très variable, suivant les domaines juridiques, les secteurs d'activité, le zones géographiques, et qu'ils ne sont pas tous d'origine purement économique. Un certain nombre d'entre eux, et non des moindres, sont de nature psychologique ou sociologique », (J. Rueff, 1960b, p. 332). Il faut donc jouer sur les mentalités et les comportements. Les rigidités psychologiques ne proviennent pas uniquement des avantages acquis. « En partie imputables au poids du passé et à l'influence des groupes d'intérêt, elles révèlent une prise de conscience insuffisante des réalités du monde moderne, donc des lacunes dans l'information de l'opinion et dans la préparation des hommes aux tâches que l'économie attend d'eux (...) Il est sans doute inévitable que le passé pèse lourd dans un pays de vieille civilisation. Ce poids du passé, dans la mesure où il traduit l'attachement à des modes de vie, à une culture, à des traditions, comporte des avantages certains et constitue notamment un facteur de stabilité. Mais, en revanche, il fait obstacle aux transformations techniques, économiques et sociales », (p. 342). Ce passage est intéressant dans la mesure où il montre la nature ambivalente des institutions, à la fois composante de l'ordre par les régularités de comportement qu'elle inspire, mais frein au changement. Les auteurs du rapport se montrent en tout cas plutôt optimistes en imputant au manque d'éducation et d'information le maintien des rigidités au sein de l'économie .
Si le rôle des idées est apparu central dans le raisonnement de J. Rueff, elle conduit encore à évoquer deux points centraux : l'art de raisonner et l'action politique. L'art du raisonnement est essentiel selon J. Rueff pour persuader les individus de la pertinence de la politique.
« Le gouvernement efficace est celui qui, en tout moment, sait rester dans l'entre-deux, mais en s'établissant aussi loin que possible de la lâcheté-qui , en matière politique, a nom démagogie-sans cependant devenir insensé, c'est-à-dire en poussant l'effort de réforme jusqu'à la limite qui est humainement acceptable et politiquement possible (...) Cette limite est d'ailleurs mouvante et se trouve elle-même grandement dépendante de l'action gouvernementale et de la confiance qu'elle inspire. Si Turgot voulait gouverner par des démonstrations, c'est parce qu'il avait la certitude que l'action réformatrice, en tout cas impopulaire, ne serait acceptée que dans la mesure où l'opinion publique en comprendrait la nécessité. Assurément, on ne convainc pas toujours avec des raisons, mais sans raison on ne convainc jamais », (J. Rueff, 1961b, p. 487).
A côté de la persuasion il faut bien entendu mettre en avant le rôle de l'action politique elle-même. Comme nous le remarquions précédemment, la place des institutions dans le raisonnement, débouche sur une implication majeure des pouvoirs publics et des hommes politiques en particulier .
« Le monde cherche et attend l'homme d'Etat qui aura l'intelligence et le courage nécessaires pour le sauver. Si cet homme d'Etat n'existe pas, ou si les circonstances politiques ne lui permettent pas de s'affirmer, la catastrophe est devant nous, certaine comme l'écrasement au sol de l'homme qui tombe du dixième étage », (J. Rueff, 1963a, p. 14) .
Cette citation montre à quel point le rôle de l'Etat est ambivalent dans le schéma rueffien. A la fois source potentielle, parfois unique, de faux droits et instrument nécessaire de mise en application de l'intérêt général. Aussi l'Etat doit-il évoluer dans des marges étroites. C'est précisément à l'établissement de telles marges que vise les « suggestions d'art politique » concluant L'Ordre social et qui renvoient au constitutionnalisme. Une telle logique, tout en révélant la "peur" du politique, traduit aussi une certaine contradiction dans l'analyse. Pourquoi en effet préférer les règles formelles (règles constitutionnelles) si les individus peuvent se laisser convaincre par la bonne politique ? Une fois de plus, les arguments de J. Rueff ne permettent pas de répondre à cette question.
Le fait que J. Rueff éprouve le besoin d'asseoir la défense de l'ordre social à partir des institutions politiques se comprend dans la mesure où la monnaie peut faire l'objet d'une manipulation de la part des dirigeants. Une lecture possible en terme de constitutionnalisme, si elle n'est pas nommée comme telle par J. Rueff, peut aisément être tirée de ses « réflexions d'art politique ». Une telle logique nous paraît intéressante car elle constitue une réponse possible à une certaine représentation de l'ordre (fondé sur les droits de propriété) et une vision particulière des institutions comme création intentionnelle. En ce sens, et contrairement à ce qu'affirme Y. Crozet (1997) , la perspective ouverte par J. Rueff n'est pas datée mais constitue au contraire une piste de réflexion conduisant à comprendre l'articulation au cœur de la théorie institutionnelle contemporaine, entre contraintes formelles et informelles . Le recours à des règles constitutionnelles, en conclusion de L'Ordre social pose deux types de problèmes concernant la logique du schéma rueffien. Elle souligne d'une part l'insuffisance de l'éducation et plus largement des institutions informelles dans la préservation du droit de propriété mais aussi une tension avec un autre espace de règles formelles, celles liées à la politique de l'étalon-or . Une telle perspective montre en tout cas que la préservation du droit de propriété passe par un panel large d'institutions.
Les règles constitutionnelles se justifient pour J. Rueff dans les cas extrêmes mais possibles où les dirigeants sont peu scrupuleux. S'ils sont pour la plupart motivés par le sentiment d'intérêt général, « il y a les cyniques et les pervers ».
« A ceux-là, la raison n'apporte aucun secours. Seule la contrainte peut modifier leurs actes (...) Actuellement il n'existe, dans la pharmacopée politique, aucune contrainte ayant cet objet. Le cynique et le pervers peuvent cueillir les fruits électoraux du déficit sans que leur désirabilité soit, à aucun moment, diminués par des sanctions contraignantes », (J. Rueff, 1945, p. 730) .
Aussi faut-il rendre les hommes politiques responsables des déficits causés. Mais J. Rueff ne précise pas la nature de cette responsabilité. On imagine mal une responsabilité sur bien propre à l'image du statut d'entrepreneur individuel . Aussi convient-il de mettre en place un cadre institutionnel approprié. Ce cadre est constitué par deux piliers : la Cour des comptes et le corps des thesmothètes. La Cour des comptes exercera le contrôle comptable des différents ministères et la mise en responsabilité.
« Le jugement de la Cour des Comptes n'aura d'influence contraignante que s'il rattache le déficit à la cause qui l'a provoqué et s'il permet de l'imputer à l'autorité qui en est responsable. Pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'à tout budget soit indissolublement associé le nom du Ministre qui l'a proposé et celui ou ceux des Ministres qui l'ont exécuté (...) Assurément, pareille procédure modifierait profondément les attributions de la Cour des Comptes ; elle lui donnerait un redoutable pouvoir d'interprétation et d'appréciation, qui en ferait, dans toute la force du terme, une Cour suprême », (J. Rueff, 1945, p. 731).
A côté de la Cour des Comptes, J. Rueff met en jeu une seconde institution, le corps des thesmothètes. Le terme thesmothète est emprunté à la tradition hellénique. Ceux-ci étaient les gardiens suprêmes de la stabilité constitutionnelle dans la république. Dans l'esprit de J. Rueff les thesmothètes doivent juger non pas de l'utilité publique des décisions parlementaires mais de leurs conséquences financières. C'est bien, une fois encore, la monnaie qui fait l'objet de la plus grande attention par une limitation des risques de manipulation. Il existe toutefois une restriction au rôle des thesmothètes, les cas de « salut public », notion qui est, en elle-même soumise à interprétation. Nous remarquerons d'ailleurs que la Constitution de 1958 aménage au chef de l'exécutif des fonctions importantes en cas de désordre politique. Le statut central des thesmothètes oblige alors à organiser constitutionnellement leur "existence". « Toutes dispositions devront être prises pour empêcher qu'ils faillissent à leur mission. Ils devront être nommés à vie par le collège des plus hautes autorités morales du pays. Comme leurs précurseurs athéniens, ils devront être « nourris aux frais de l'Etat » », (p. 732). A ces deux piliers J. Rueff en ajoute un troisième qui est le succédané du premier mais au niveau international.
« Ces diverses précautions contre le désordre financier présentent un caractère national. Cependant, en régime de monnaie métallique, la gestion financière de chacun des Etats à monnaie-or affecte le sort de tous les autres. L'ordre financier n'est donc plus une question nationale, mais internationale au premier chef » (J. Rueff, 1945, p. 732).
Une Cour des Comptes internationale aurait ainsi pour objectif de contrôler les budgets nationaux. La nécessité d'une mise en place à l'échelle mondiale du cadre institutionnel pose évidemment la question de la convergence des intérêts.
Le dispositif institutionnel imaginé par J. Rueff apparaît de toute évidence conforme à sa conception des vrais droits et l'obligation induite de financer les dépenses de l'Etat exclusivement par voies d'imposition. Un lien peut sur ce point être opérée avec la critique précédente concernant la rigidité des faux droits. Ne pourrions-nous, toujours par voie, si ce n'est constitutionnelle au moins réglementaire, établir des restrictions plus souples ? De toute évidence le critère monétariste lié au suivi d'un agrégat monétaire ne serait pas en conformité avec la théorie monétaire rueffienne ; c'est-à-dire le fait de corréler le taux de croissance d'un agrégat à celui du taux de croissance de l'économie . Ne pourrions-nous alors imaginer que le taux de croissance du déficit public ne puisse dépasser le taux du PIB ? Cela donnerait en tout cas sens, pensons-nous, à l'idée d'un assouplissement de la définition des vrais droits .
**
*
La conception rueffienne du droit de propriété, en commandant certains comportements, débouche sur une théorie au moins implicite des institutions. Le comportement marchand réclamé par la flexibilité des prix n'est pas spontané et appelle une certaine régulation, à la foi formelle avec les sanctions associées au non-respect et informelle avec l'action sur les consciences-sur les préférences mêmes des individus. Il semble alors que cette théorie implicite des institutions demeure problématique. Nous avons vu en effet que la politique monétaire venait buter sur des exigences contradictoires, liées notamment à l'acceptation des règles marchandes et au rapport modèle-pratique des agents. Le rôle donné à la fois à l'éducation et aux règles constitutionnelles laisse à penser que le modèle fondé sur les vrais droits doit finalement s'imposer à la réalité.
Conclusion
En montrant la nécessité d'un rapprochement entre le droit et l'économie, J. Rueff a mis en perspective toute une réflexion concernant les conditions de l'ordre social. Y a-t-il pour le moins réussi ?
En fait J. Rueff ne parvient pas à donner une réponse cohérente à l'articulation nécessaire des normes marchande et juridique. La problématique oscille en effet constamment entre deux tendances : celle d'un droit respectueux du bon et libre fonctionnement du marché et celle d'un droit antérieur au marché pouvant jouir de ce fait d'une certaine autonomie. Cette dualité d'analyse est apparue centrale dans la mesure où les exigences portées par le respect du droit de propriété, notamment en termes de discipline de comportement, paraissent exorbitantes. Aussi convient-il de dégager les responsabilités propres à chaque sphère, bien que le lien droit de propriété-marché paraisse indissoluble. Soit la définition tirée du Code civil est trop rigoureuse et dans ce cas il suffit d'en modifier le contenu . Soient les exigences du marché sont trop fortes et il faut les amender, dans une perspective institutionnelle. Mais un tel questionnement pose toujours la question de la norme à suivre. Sur quel modèle économique apprécier les conséquences économiques inévitables des règles et décisions de justice ? Reste à savoir ensuite si la réponse est indépendante ou non des institutions juridiques encadrant l'activité économique. Une réponse positive impliquerait une certaine autonomie de la théorie économique, à supposer bien entendu qu'elle puisse relever du vrai (économie pure) et non pas du devoir-être (économie normative) . Par ailleurs dire que l'application du droit de propriété est économiquement exigeante, ne revient-il pas à dire que le réel est « libéral »?
Tout dépend alors de ce qu'on entend par intérêt général et ordre social. Or nous avons vu que J. Rueff hésitait sur cette question en ne proposant pas de définition claire de l'ordre social. Est-il lié à la défense des vrais droits (et donc au respect de la flexibilité des prix, ce qui induit une certaine discipline), à la défense de la morale (qui peut par exemple permettre la discipline recherchée) ? La question se pose d'autant plus que l'inflation (associée au désordre) risque de ne pas avoir qu'une cause budgétaire exogène. Nous pouvons alors considérer que l'ordre social revient à associer exigences économiques et exigences morales. Mais si l'articulation précise à trouver entre les deux dépend des circonstances, le public acceptera t-il continûment la discipline marchande ? La solution constitutionnelle proposée par J. Rueff ne traduit-elle pas la nécessité d'imposer des principes libéraux ? Le droit viendrait au secours de l'économie parce que cette dernière constitue une norme indépassable...
Le droit de propriété est bien au centre d'une relation fondamentale et d'une tension potentielle entre des exigences à concilier. La solution risque par conséquent fort d'être politique.