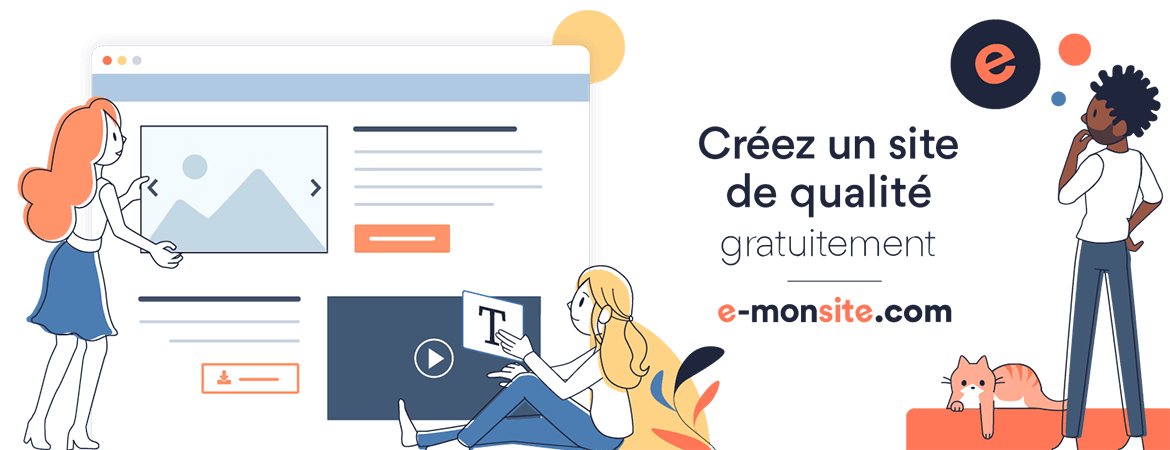l'ordre libéral
Coase et la théorie du comportement
![]() Par
LONGUEPEE Daniel
Le 01/04/2022
Par
LONGUEPEE Daniel
Le 01/04/2022
Dans la présentation qu'il a fait de l'Ecole de Chicago sur France Culture http://www.franceculture.fr/emission-les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance-les-ecoles-de-chicago-24-le-neoliberalisme-americaihttp://www.franceculture.fr/emission-les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance-les-ecoles-de-chicago-24-le-neoliberalisme-americai , Alain Laurent laisse planer une ambiguïté embarrassante concernant la théorie implicite du comportement. Si à l'origine avec Frank Knight l'universalisation de l'hypothèse de maximisation de l'utilité—c'est-à-dire d'individus adaptant en toutes circonstances des moyens rares à leurs objectifs—est une « folie », ce ne serait plus le cas à partir de Milton Friedman et de ses continuateurs. Le problème c'est qu'en inscrivant logiquement Ronald Coase à côté de Stigler ou Gary Becker parmi ces continuateurs, A. Laurent commet un imprudence. Bien que dans la mouvance libérale, Coase n'a en effet jamais cessé de s'interroger sur les limites de l'hypothèse de rationalité maximisatrice. Si A. Laurent constate la nature évolutive de l'Ecole de Chicago en distinguant Knight et Friedman, sans doute faudrait-il aussi s'interroger sur la cohérence de cette "école". Coase apparaîtra en tout cas plus proche de Knight que de Friedman sur la conception du comportement. Pour illustrer cette proximité, , il suffira de s'appuyer sur quelques citations de R. Coase :
1/« Puisque les individus qui opèrent dans le système économique sont les mêmes que ceux l’on trouve dans le système juridique ou politique, on peut espérer que leur comportement sera, dans un sens large, similaire. Mais cela ne signifie en aucun cas qu’une approche développée pour expliquer le comportement dans le système économique se réalisera aussi avec succès dans les autres sciences sociales. Dans ces différents champs, les objectifs que les individus poursuivront ne seront pas les mêmes et, en particulier, la structure institutionnelle dans laquelle les choix seront faits ne sera pas la même », (R. Coase, 1975, pp. 42-43).
2/« Il n’y a aucune raison de croire que la plupart des être humains maximisent quoi que ce soit tant que ce n’est pas déplaisant, et même avec un succès incomplet », (R. Coase, 1988a, p. 4).
3/« Mais il est, bien entendu, désirable que le choix entre différents arrangements sociaux pour la solution de problèmes économiques doit être entreprise dans des termes plus larges que cela et que l’effet total de ces arrangements dans toutes les sphères de la vie doit être pris en compte. Comme Frank H. Knight l’a souvent remarqué, les problèmes de bien-être économique doivent en dernier recours se dissoudre dans une étude esthétique et morale », (Coase, 1960, p. 43).
Outre la référence explicite à Knight, cette citation est d'autant plus importante qu'elle conclut The Problem of social cost. C'est cet article qui a servi de fondement à l'énoncé du célèbre « théorème de Coase » justifiant la maximisation de la valeur de la production lors de l'attribution des droits de nuisance. On pouvait croire à travers les cas analysés par Coase que le critère d'efficience devait être structurant; Or ce n'est pas le cas.
4/« (...) placé dans un choix entre une théorie qui prédit bien mais nous donnant peu d’éléments sur le fonctionnement du système et une qui nous donne ces éléments mais prédit mal, je choisis la dernière », (R. Coase, 1981, p. 17).
Cette citation est importante dans la mesure où elle constitue une critique de la méthodologie friedmanienne du « as if ». Pour M. Friedman en effet, ce n’est pas tant le réalisme des hypothèses qui importe que leur capacité prédictive. Peu importe par exemple que les entreprises n’aient pas conscience de maximiser leur profit. Le processus d’évolution fait que seules les meilleures survivent et il est possible de considérer qu’elles ont agi comme si elles l’avaient effectivement maximisé. Et c'est une telle conception que R. Coase conteste. D'où :
5/« Dire que les individus maximisent leur utilité ne nous dit rien sur les raisons pour lesquelles ils s’engagent dans des activités économiques et nous dit rien sur le fait de savoir pourquoi les individus font ce qu’ils font », (R. Coase, 1975, p. 43).
En tout cas un auteur comme Posner prétendra même que la démarche de Coase est « anti-théorique »! CE faisant la critique de Posner s’adresse non seulement à Coase mais aussi à Williamson. Or sur ce point la réponse de Coase est sans ambiguïté :
6/ « Posner s’oppose aux concepts adoptés par Williamson comme celui de “ rationalité limité ”. J’ai aussi des réserves sur ce concept comme j’en ai sur tout concept économique qui comporte le mot “ rationnel ” (...) Quelque soit le résultat, l’approche fondamentale de Williamson sera non affectée », (Coase, 1993, p. 98).
7/« Je voudrais souligner que la croyance dans la main invisible n’implique pas que le gouvernement n’a pas de rôle à jouer dans le système économique. C’est tout le contraire. Si il est en général vrai que les hommes, suivant leur propre intérêt personnel agissent dans une voie qui est bénéfique pour la société, c’est, pour citer Edwin Cannan, « parce que les institutions humaines sont arrangées pour obliger l’intérêt personnel à travailler dans des directions où il sera bénéfique ». Notre tâche comme économistes est d’aider à l’élaboration et l’amélioration de telles institutions. En faisant cela, nous ne devons pas ignorer la face noble de la nature humaine quand cela peut être mis en jeu », (R. Coase, 1966, p. 444).
Pour les quelques références bibliographiques :
(1960) : « The Problem of Social Cost », The Journal of Law and Economics, 3, n°1, pp. 1 - 44.
(1966) : « The Economics of Broadcasting and Government Policy », American Economic Review, 2, may, pp. 440-47.
(1975) : « Economics and Contiguous Disciplines », présenté lors de l’Association internationale d’économie à Kiel, reproduit dans R. Coase, 1994, pp. 34-46.
(1981) : « How Should Economists Choose », The third G. Warren lecture in political economy, délivrée le 18 novembre au American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington D. C. , reproduit dans R. Coase, 1994, pp. 15-33.
(1988a): « The Firm, the Market and the Law », dans The Firm, the Market, and the Law, The University of Chicago Press, 1988, Paperback edition, 1990, pp. 1-31.
(1993) : « Coase on Posner on Coase », Journal of Institutionnal and Theorical Economics, 149/1, pp. 96-98.
(1994): Essays on Economics and Economists, The University of Chicago Press.
Marché-institution ou institutions marchandes ?
![]() Par
LONGUEPEE Daniel
Le 02/03/2022
Par
LONGUEPEE Daniel
Le 02/03/2022
1° Le marché est lui-même une institution. Le marché, c'est un mode particulier de circulation des richesses. Cela signifie qu'il y a des procédures, des pratiques, des habitudes, des lieux précis permettant les échanges, les achats et les ventes : des magasins, des supermarchés, les ventes privées sur le web, bref une continuité temporelle qui structure notre quotidien. Quand on se couche le soir le supermarché était bien là la journée et quand on se réveille le lendemain matin il est encore là ! Des magasins peuvent fermer mais il y en aura d'autres. Il y aura toujours un endroit pour acheter ce que l'on désire. C'est essentiel et tellement essentiel que nous n'y pensons même plus : les acheteurs savent qu'il pourront acheter et les vendeurs savent qu'ils pourront vendre. Voilà pourquoi le marché est une institution, qu'il y ait ou non gain à l'échange. Il s'inscrit dans le temps, il dure et il durera encore demain. C'est ce que rappelle Roger Gusnerie dans L'Economie de marché publié en 2013, les marchés sont « eux-mêmes des institutions ». Les individus à force de réaliser des échanges marchands s'approprient les mécanismes du marché, tentent d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. C'est une seconde nature. Voilà pourquoi les soldes ont du succès ou les ventes privées sur le web. C'est aussi pour cette raison que le passage des anciennes économies soviétiques au capitalisme a pris du temps. Les entreprises ont du réapprendre à recruter, à faire appel aux meilleurs fournisseurs, à maximiser leur bénéfice. Tout cela n'est pas spontané et prend du temps.
2° Le marché a besoin d'institutions. Mais le raisonnement ne s'arrête pas là. « Les marché n'existent pas ex nihilo ». Ils ne tombent pas du ciel. Sur ce point toutefois tous les économistes ne sont pas d'accord. Celui qui est considéré comme le « père fondateur » de l'économie, Adam Smith (1723-1790), partait du principe qu'il existait dans chaque homme « une propension à l'échange et au troc ». Dans ces conditions le marché est spontané et ne semble pas avoir besoin d'expérimentations. Toutefois, et c'est une des dimension importante du marché institutionnel, il faut au minimum pour qu'il y ait échange une reconnaissance mutuelle des propriétés de chacun. Smith l'admettait il faut que les échangistes sachent réciproquement ce qui leur appartient, ce qui appartient à l'autre : « Ceci est à moi, ceci est à toi ». En bref, l'échange a besoin de règles juridiques liés au minimum au respect des propriétés initiales. Il n'y a pas d'échange là où il y a vol et pillage CAD là où la propriété d'autrui n'est pas respectée ! C'est ce que rappelle Guesnerie, l'existence des marchés « dépend elle-même d'un certain nombre d'autres institutions. La première de ces institutions est sans doute l'institution juridique ». Par exemple c'est l'article 544 du Code Civil (Code Napoléon) qui consacre la propriété privée. Parmi les règles juridiques, les brevets jouent un rôle important. Si un inventeur ou un créateur (industriel, artistique, …) n'a aucune protection juridique, CAD qu'il peut se faire copier et diffuser ses idées, il n'aura plus aucune incitation à créer. Il n'y aura plus de marché pour les « choses » nouvelles. Aussi le brevet accorde t-il généralement pour une durée de 20 ans le monopole d'une invention. Une fois le brevet enregistré, l'inventeur peut exploiter lui-même son invention ou la revendre à une entreprise qui l'exploitera. Enfin les règles juridiques définissent aussi ce qu'il est possible d'échanger pas. Il y a l'exemple de l'édit de 1764. Mais de nos jours par exemple, l'échange de sang ne relève pas du marché mais du don. On ne vend pas son sang, on le donne, en France en tout cas. C'est la même chose pour les organes. On suppose que des règles morales minimales sont nécessaires, ce qui limite l'étendue des relations marchandes, CAD de ce qu'il est permis d'échanger ou pas. D'où tout le débat sur la gestation pour autrui, CAD le principe des mères porteuses. Jusque maintenant, la loi française interdit ce type de pratique. Le risque c'est de créer un véritable marché des bébés, d'où l'image provocatrice dans le dossier : « Mère porteuses. Soldes ! ». Certaines auteurs libéraux extrémistes sont d'ailleurs favorable à un tel marché, comme M. Rothbard. Celui-ci ne reconnaît qu'une seule règle : le respect de la propriété privée. La femme est propriétaire de son corps et donc de ce qui « en sort » comme des bébés. Pourquoi pas les vendre, alors ?
1° En quoi les soldes illustrent-elles le marché-institution ? 2° Pourquoi la propriété est-elle une institution fondamentale du marché ? 3° Montrez que l'on peut distinguer les notions de « marché comme institution » et d' « institutions nécessaires au marché ».
![]() Par
LONGUEPEE Daniel
Le 16/05/2010
Par
LONGUEPEE Daniel
Le 16/05/2010
Les marchés financiers s'inquiètent encore, les médias le "confirment", des finances publiques en Europe. Outre que nous ne savons pas vraiment ce que sont "les" marchés financiers, s'ils incarnent une volonté propre, s'ils sont l'émanation d'une souveraineté économique (légitime), il convient de nous interroger sur les raisons profondes justifiant une telle inquiétude et l'importance à lui donner. Nous avions cru comprendre qu'il fallait discipliner les marchés, qu'il fallait passer à une nouvelle phase de la globalisation économique en brisant la logique des "3 D" qui a structuré l'épopée financière des dernières décennies. En fait, la politique de la France semble plus que jamais se faire "à la corbeille", et ce sont les investisseurs privés du monde entier, sans aucune concertation, du moins nous pouvons l'espérer, qui disciplinent les Etats. Il est vrai que la question de la discipline est récurrente en économie. Que l'on songe à la discipline des travailleurs par la peur du chômage chez Shapiro et Stiglitz ou à la discipline des managers par le profit chez Alchian et Demsetz. Pas besoin de camps, la rationalité fait toujours son oeuvre en économie. Aussi faut-il songer à discipliner les Etats, c'est indéniable. Le marché a au moins cette vertu. Il interdit aux Etats qui veulent emprunter de faire n'importe quoi. Si leur endettement est jugé excessif, alors ils devront payer une sur-prime, comme la Grèce en a fait la cruelle expérience. Cela signifie, au passage, qu'il y a des investisseurs, pour ne pas dire des rentiers, qui sont bien contents de trouver des Etats endettés sur lesquels ils pourront encore ponctionner un peu de richesse. Mais c'est une autre histoire, l'intérêt n'est plus condamné par la Religion. Aussi pour reprendre notre histoire sur les contraintes à imposer aux pouvoirs publics eux-mêmes faut-il revenir à J. Rueff. Son oeuvre nous permettra de comprendre en même temps que la crise financière actuelle, les moyens déjà mis en oeuvre, en Europe, pour contraindre les Etats. J. Rueff est omnubilé par l'inflation, comme le seront plus tard les monétaristes. « Bien plus que l'idéologie marxiste, l'inflation engendre l'esprit de classe. Par le sentiment de frustration qu'elle suscite dans la plus large partie de la population, celle qui eût du être mieux protégée, elle fait naître la volonté de subversion sociale et de révolution », (J. Rueff, 1952, p. 82). Aussi dans une logique toute constitutionnaliste, propose-t-il un cadre institutionnel à 2 piliers : une cours des comptes et un corps de themosthètes, dans une veine antique. La Cour des comptes exercera le contrôle comptable des différents ministères et devra engager la responsabilité des ministres concernés en cas de non respect de l'équilibre budgétaire. « Le jugement de la Cour des Comptes n'aura d'influence contraignante que s'il rattache le déficit à la cause qui l'a provoqué et s'il permet de l'imputer à l'autorité qui en est responsable. Pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'à tout budget soit indissolublement associé le nom du Ministre qui l'a proposé et celui ou ceux des Ministres qui l'ont exécuté (...) Assurément, pareille procédure modifierait profondément les attributions de la Cour des Comptes ; elle lui donnerait un redoutable pouvoir d'interprétation et d'appréciation, qui en ferait, dans toute la force du terme, une Cour suprême », (J. Rueff, 1945, p. 731).
A côté de la Cour des Comptes, J. Rueff met en jeu une seconde institution, le corps des thesmothètes. Le terme thesmothète est emprunté à la tradition hellénique. Ceux-ci étaient les gardiens suprêmes de la stabilité constitutionnelle dans la république. Dans l'esprit de J. Rueff les thesmothètes doivent juger non pas de l'utilité publique des décisions parlementaires mais de leurs conséquences financières. C'est bien, une fois encore, la monnaie qui fait l'objet de la plus grande attention par une limitation des risques de manipulation. Il existe toutefois une restriction au rôle des thesmothètes, les cas de « salut public », notion qui est, en elle-même soumise à interprétation. Nous remarquerons d'ailleurs que la Constitution de 1958 aménage au chef de l'exécutif des fonctions importantes en cas de désordre politique. Le statut central des thesmothètes oblige alors à organiser constitutionnellement leur "existence". « Toutes dispositions devront être prises pour empêcher qu'ils faillissent à leur mission. Ils devront être nommés à vie par le collège des plus hautes autorités morales du pays. Comme leurs précurseurs athéniens, ils devront être « nourris aux frais de l'Etat » », (p. 732). A ces deux piliers J. Rueff en ajoute un troisième qui est le succédané du premier mais au niveau international. « Ces diverses précautions contre le désordre financier présentent un caractère national. Cependant, en régime de monnaie métallique, la gestion financière de chacun des Etats à monnaie-or affecte le sort de tous les autres. L'ordre financier n'est donc plus une question nationale, mais internationale au premier chef » (J. Rueff, 1945, p. 732). Une Cour des Comptes internationale aurait ainsi pour objectif de contrôler les budgets nationaux. Or n'est-ce pas précisément ce qui est arrivé aux pays de la zone euro récemment? N'ont-il pas du accepté, en contrepartie de la création d'un fonds européen de défense monétaire, que la Comission de Bruxelles jette un regard inquisiteur sur leurs finances et leurs projets de budget? Plutôt de dire que Rueff retrouve une certaine actualité, il nous faudrait plutôt croire que l'Histoire, comme souvent, se répète et que la théorie économique n'a finalement pas beaucoup de solutions originales à proposer. De toutes façon l'Europe a déjà adopté une voie constitutionnaliste depuis les traités de Maastricht, avec ses critères d'adhésion à la monnaie unique, et d'Amsterdam avec son Pacte de stabilité et de croissance. Les amendes prévues par ce dernier devaient jouer un rôle disciplinaire du fait de leur caractère public et exogène. Ce dispositif s'inspire en tout cas implicitement de la conception que se fait J. Rueff du marché, de l'Etat et surtout du droit de propriété. Pour lui en effet l'Etat crée des faux droits en monétisant sa dette, c'est-à-dire qu'il crée de la monnaie sans contrepartie véritable en termes de richesses. Aussi préconisait-il l'équilibre budgétaire et le financement des dépenses exclusivement par l'impôt. Or il se trouve d'une part que le budget "fédéral" européen repose sur cette règle d'équilibre et d'autre part que la Banque centrale ne vient d'obtenir que très récemment le droit de monétiser la dette des entreprises et des Etats. Le problème toutefois, c'est que l'Etat n'est pas toujours le seul responsable de la création de faux droits. Il se trouve que pour J. Rueff le système bancaire peut, en favorisant les crédits susciter de l'instabilité monétaire. L'inflation des actifs, mobiliers et immobiliers, n'est pas moins réelle que l'inflation associée à l'indice des prix. Or c'est précisément ce qui est advenu avec la crise des subprimes dont nous ne finissons pas aujourd'hui de payer le prix. L'endettement public actuel est la conséquence de l'endettement privée des années passées. Pour éviter une faillite du système, une dette privée a été transformée en dette publique. C'est ce qui se passe lorsque l'Etat garantit des actifs, nationalise des banques, "relance" l'économie. De ce point de vue il semblerait logique de dire "aux" marchés financiers : "Ce n'est pas nous, Etats, qui avons commencé"! Alors la question est posée : Fallait-il laisser les banques privées faire faillite il y a 2 ans? Fallait-il, avec calme mais détermination, dire aux clients de Natixis, très engagée dans les subprimes : "Vous avez placé votre argent dans la mauvaise banque. Vous avez pris vos risque et tant pis pour vous". Et si cela avait touché une banque de dépôt comme le Crédit agricole ou la BNP, aurait-il été courageux ou menteur de dire aux déposants, non plus nécessairement épargnants : "Vous pensiez que vos comptes bancaires, qui ne sont pas des placements, mais de simple comptes de transit étaient sûrs. Et bien non! Ils ne l'étaient pas et il fallait y songer avant!" Comme je l'ai indiqué dans mon précédent billet, et suivant en cela toute une tradition d'économistes, dont S. Diatkine qui m'a enseigné ce point de vue, la monnaie est un objet spécial et sa "gestion" ne saurait être confiée sans limite aux mécanismes du marché. Certes elle ne l'est pas puisqu'il existe des banques centrales qui relèvent des pouvoirs publics. Toutefois il reste les banques de second rang. En tout cas la monnaie est bien de ce point de vue une institution, c'est-à-dire qu'elle est dépositaire de règles collectives de gestion en même temps qu'elle révèle la nature extrêmement précaire des relations humaines, qu'elles soient économiques ou autres.
Le libéralisme peut-il se définir comme un système de droits légitimes ?
![]() Par
LONGUEPEE Daniel
Le 14/04/2010
Par
LONGUEPEE Daniel
Le 14/04/2010
Je ne saurais dire que du bien de l'émission "Du grain à moudre " sur France culture. Le thème du jeudi 1er avril fut consacrée à l'après capitalisme et aux raisons de la crise actuelle. Parmi les intervenants, Pascal Salin a une fois de plus ressortis les vieilles ficelles de la rhétorique libérale. Selon lui par exemple le capitalisme se définit comme une économie fondée sur des droits de propriété légitimes. Mais une telle définition est bien trop large pour servir de guide. Elle permet de réfléchir à la manière dont les individus doivent composer avec des ressources rares et dans ce cas un régime de propriété est nécessaire pour allouer des droits aux individus. Mais elle ne permet pas de caractériser "le" capitalisme. Elle évacue les questions pourtant centrales du profit, des positions dominantes et des rapports de force. La notion de légitimité, bien qu'importante, ne dit encore rien sur le contenu précis du régime de propriété. Ce qui est légitime pour une société peut ne pas l'être pour une autre. On comprend que la définition proposée par P. Salin reste finalement assez neutre et muette sur le fond du problème qui est en fait la justification de la propriété privée sur toutes les ressources. D'ailleurs, et c'est l'argumentation libérale basique, la gestion des ressources est la plus efficace lorsque règne un régime de propriété privée. Dans ce cas, les propriétaires sont incités à valoriser les ressources sur lesquelles ils ont les droits. Si certaines ressources naturelles disparaissent, c'est uniquement parce qu'elles ne font pas l'objet d'un droit de propriété privée. C'est la propriété publique ou commune des ressources qui occasionnent des gaspillages. De là le discours de Salin sur le capitalisme comme solution à la crise. Mais le passage propriété commune/propriété privée ne va pas de soi. Il implique au minimum des effets redistributifs dont il faut tenir compte.
Toute la difficulté tient ensuite à tenir ensemble la nécessité de droits légitimes avec le disours libéral sur la supression de l'Etat. Comme il est rappelé, non sans ironie dans l'émission, le libéralisme est constituée de plusieurs chapelles. Et Salin se positionne ouvertement dans la perspective autrichienne issue de Hayek. Déjà à ce stade, Stéphane Longuet (Hayek et l'école autrichienne, CIRCA) a montré qu'il n'y avait pas d'unité au sein de l'Ecole autrichienne, voir mêmes des divergences profondes. De plus il existe aussi des auteurs, notamment au sein de l'économie néo-institutionnelle, qui admettent la nécessaire intervention de l'Etat pour garantir les droits de propriété. L'Histoire de la pensée économique est riche d'enseignement sur les conditions des droits légitimes. Appuyons-nous, au minimum, sur deux auteurs français : Léon Walras (1834-1910) et Jacques Rueff (1896-1978). Certes ces derniers s'inscrivent dans un libéralisme un peu particulier, disons le libéralisme rationnel "à la française" où le marché suppose des règles qui ne viennent pas spontanément. Ainsi dans une tradition libérale plus anglo-américaine, les règles de droit ont pour origine les règles du commerce (respect des contrats, ostracisme en cas d'infraction, etc.) et n'ont pas besoin d'être "étatisées". Elles émergent spontanément à partir des pratiques des acteurs non sans parfois conduire à des impasses, comme le souligne Hayek lui-même, nécessitant une intervention du législateur pour suppléer au juge. Il est vrai que dans ce cas, c'est le common law qui sert de référence. On comprend que des auteurs français disposent d'autres sources d'inspiration. C'est très clair pour Rueff qui s'appuie expressément sur l'article 544 du Code civil pour montrer que le droit de disposition qu'il consacre implique un marché concurrentiel. De même pour Walras seul un marché concurrentiel permet un échange ne contredisant pas la répartition de la richesse fondée en droit naturel. Le salariat est juste pour Walras car il proportionne les rémunérations aux mérites individuels. Toutefois pour en arriver là, il faut un Etat fort, guidé par une rationalité supérieure et instituant les règles nécessaires au fonctionnement du marché. Cette idée de fond est partagée à la fois par Walras et Rueff, ce dernier ayant été un grand commis de l'Etat, inspirant au passage, la politique économique du général De Gaulle. Un marché concurrentiel implique qu'aucune entreprise ne dispose d'un pouvoir quelconque à la fois sur les consommateurs mais aussi sur les salariés. Walras s'en prend par exemple aux entreprises qui allongent la durée du travail pour accroître leurs bénéfices. Aussi préconise-t-il l'intervention d'inspecteurs. Rueff va évoluer sur la question des rigidités. S'il fustige dans un premier temps le rôle des allocations chômage, dans un article qui le consacrera pour longtemps comme libéral orthodoxe, il finira par admettre les aspects positifs du salaire minimum et défendra une conception social-démocrate du travail.
Par conséquent avoir des droits ne signifie pas donner tous les pouvoirs aux propriétaires même dans la limites du respect du droits des autres. L'Etat dispose d'un domaine réservé ou au minimum les pouvoirs publics. Bien entendu tout n'est pas faux dans le raisonnement de Salin. Concernant le déclenchement de la crise, à travers les subprimes, il est évident ques les autorités ont incité les banques à prêter aux ménages pauvres pour compenser la perte de pouvoir d'achat de ces derniers. Or comme on dit souvent, on ne peut vivre indéfiniment à crédit. Mais lorsque Salin prétend qu'il faut laisser les grands établissements faire faillite s'ils ont été imprudents, croit-il vraiment qu'on peut dire aux clients de la banque que leurs avoirs seront tout bonnement soldés. Nous touchons ici à la spécificité des banques dans le système capitaliste. Elles sont en parties des organismes publics. Elles sont au coeur des paniques financières et des prophéties auto-réalisatrices. Ce sont d'ailleurs les crises financières qui nous font comprendre pourquoi on parle de monnaie fiduciaire-monnaie en laquelle on a confiance. Que la confiance disparaisse, et c'est tout le système qui s'effondre. Alors certes Salin pourra rétorquer qu'un système de banques privés sans banque centrale a existé aux Etats-Unis avant la crise de 1929, et que les titulaires de comptes bancaires prennent des risques en déposant simplement leurs avoirs (salaire, épargne) dans leur banque. La discipline marchande doit aussi s'imposer à eux. Et c'est bien là tout l'enjeu : A quel niveau de protection minimal peut prétendre chacun d'entre nous dans la sphère économique et si une telle protection a droit de citer? La réponse déborde le champ de l'économie pour atteindre celui de la philosophie. On peut considérer que vivre c'est en soi prendre des risques et qu'aucune protection ne peut être garantie. La vie impose d'être constamment sur ses gardes et de faire des choix irréversibles qui pourront se révéler mauvais. En ce sens la discipline marchande est le prolongement logique de la discipline qu'impose la vie elle-même. Ne sommes-nous pas dans ces conditions ramené au darwinisme social?