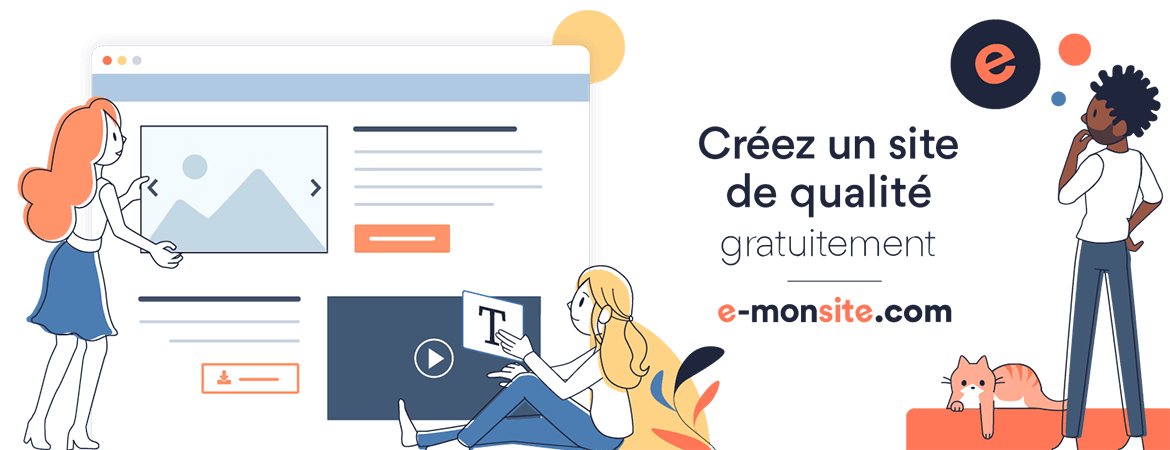Les facteurs de la croissance
Comment utiliser la notion de choc en économie?
![]() Par
LONGUEPEE Daniel
Le 20/09/2012
Par
LONGUEPEE Daniel
Le 20/09/2012
Qui n'a pas entendu parler du choc pétrolier de 1973 (multiplication par 4 du prix du pétrole) marquant la fin des "30 Glorieuses" ? Un choc, par définition, est quelque chose d'inattendu, voire de brutal. On a pu parler ainsi de la stratégie de thérapie de choc pour qualifier les politiques libérales de privatisations et de désengagement de l'Etat dans les ex-pays socialistes. Il s'agissait alors de passer très rapidement (instantanément?) d'une économie planifiée à une économie de marché. D'un point de vue plus général, la notion de choc sert à modéliser les perturbations qui peuvent affecter le sacro-saint point d'équilibre entre l'offre et la demande sur les différents marchés mais aussi d'interpréter les fluctuations qui traversent l'activité économique. C'est ce dernier versant qui nous intéressera ici. Deux types de chocs vont pouvoir exister, les uns affectant la demande, les autres l'offre. Classiquement les chocs d'offre renvoient à ce qui touche aux conditions de production : productivité du travail et coûts de production. Les chocs de demande touchent à l'ensemble des composantes de la demande globale (on quitte ici la sphère d'un marché particulier pour atteindre toute l'économie) que l'on peut décrire dans l'équilibre emplois-ressources : dPIB = dC + dI + dStocks + d(X-M).
Mais les choses ne sont rarement aussi simples qu'elles y paraissent. Ainsi où situer un investissement de rationalisation (une machine plus performante) qui permet d'accroître (soudainement) la productivité de l'entreprise? Le choc d'offre passe ici nécessairement par l'investissement donc par une composante "demande". Par ailleurs s'agit-il d'un "choc" ou d'une diffusion progressive d'une méthode de production à l'ensemble de l'économie, éventuellement à travers un processus d'erreurs et d'essais s'inscrivant forcément dans la durée? Les chocs pétroliers, évoqués plus haut, relèvent-ils pour leur part de chocs d'offre ou de chocs de demande? Ils perturbent négativement, et les conditions de production en alourdissant le coût des consommations intermédiaires des entreprises, et le pouvoir d'achat des ménages qui devront soit diminuer les autres postes budgétaires (puisque celui consacré à l'énergie comme le carburant ou le fioul augmente), soit puiser dans leur épargne. A titre d'illustration le dictionnaire d'Economie et de sciences sociales de Nathan ainsi que le manuel de Terminale ES - Bordas les considèrent comme des chocs d'offre. Par contre le manuel Hachette en fait un exemple de choc de demande, du moins en tant que source d'une augmentation du prix de l'énergie affectant le pouvoir d'achat des ménages. La synthèse de ce manuel ajoute que la demande joue de toute façon un rôle essentiel et que "quelle que soit la nature du choc (de demande ou d'offre), il transite nécessairement par la demande". Mais ne pouvons-nous considérer aussi que "l'offre crée sa propre demande", par exemple la généralisation du portable, objet qui n'existait il y a 20 ans ? De la même façon, le rôle du crédit dans le cadre de ce qu'on appelle le cycle du crédit a des effets sur la demande (crédits aux consommateurs) ainsi que sur l'offre (financement des investissements des enteprises). Il est de toute façon difficile de trancher, ce que confirme une lecture en terme de croissance potentielle.
La notion de croissance potentielle est utilisée pour l'analyse de la conjoncture et des politiques économiques à mener. Si l'on mesure la croissance économique par le PIB, on obtient la définition suivante : "Le PIB potentiel fait référence à un sentier de croissance de long terme que l'économie devrait suivre en l'absence de chocs exogènes et de tensions" (T. Jobert, X. Timbeau : L'Analyse de la conjoncture, La découverte). En effet les éléments jouant sur la croissance potentielle sont généralement considérés comme des facteurs d'offre : productivité, coût relatif du travail, démographie et taux d'emploi, alors qu'en face, la croissance effective est liée aux aléas conjoncturels de la demande globale. Soit on considère que la croissance potentielle est structurelle et que la croissance réelle tend en moyenne à la rejoindre à long terme. On considère alors et il s'agit d'une hypothèse importante que la croissance potentielle est insensible aux aléas conjoncturels (cf. L'analyse de la conjoncture, de T. Jobert et X. Timbeau). Soit on considère, au contraire, que la croissance effective influence la trajectoire de la croissance potentielle à travers les effets des variations de la demande sur l'offre. Par exemple une faiblesse durable de l'investissement déprime la demande mais au-delà entame le capital humain, l'innovation et donc les chances de croissance future potentielle. Difficile de dire donc quel est l'effet déterminant : l'offre ou la demande?
De toute façon, il semble que la notion de choc repose sur un biais idéologique lui interdisant une stabilité conceptuelle. Comme le défend B. Guerrien dans son Dictionnaire d'analyse économique, le notion de choc n'est pas neutre, comme c'est souvent le cas d'ailleurs en sciences économiques et sociales. Elle apparaît en effet dans les analyses qui considèrent que les agents économiques sont forcément rationnels, qu'ils connaissent en moyenne le modèle de l'économie et qu'ils ne peuvent être trompés que par des événements intempestifs, soit exactement ce que signifient des "chocs". Ces derniers ne peuvent donc venir de la sphère économique elle-même, ils sont exogènes. D'ailleurs le dictionnaire Nathan évoqué précédemment, les définit comme des "impulsions exogènes dont la propagation perturbe l'activité économique générant des fluctuations et dont la répétition engendre des fluctuations à caractère cyclique". Mais si on considère que les marchés sont intrinséquement instables, alors la notion de choc n'a plus vraiment de sens. C'est ce que tentent de montrer les approches en termes de cycles endogènes dont l'oscillateur de Samuelson (multiplicateur + accélérateur) constitue une bonne illustration. Est-ce alors la notion de choc d'offre exogène qui est impropre? Il est encore loisible de penser que les dépenses de recherche et développement dont le but est de générer des profits (cf. croissance endogène) peuvent créer des chocs d'offre du fait de l'imprévisibilité de la recherche.
Toujours dans le cadre d'une remise en perspective de la notion de choc en économie, il faut s'interroger sur leur caractère propre : Sont-ils bons ou mauvais pour l'économie? Comment interpréter par exemple la hausse du prix des matières premières ? Fléau pour les pays industrialisés et/ou à forte croissance? Mais n'est-ce pas leur faire prendre conscience de la rarefaction de certains produits et donc les inciter à s'adapter par l'innovation énergétique par exemple? Bienfait pour les pays producteurs de matières premières? Tout dépend en fait de l'utilisation qui est faite du surcroît de recettes. S'il favorise une élite portée sur la consommation de luxe, le risque est grand de voir les importations augmenter ce qui dégradera le solde extérieur ! Dans ce registre il importe de surcroît de distinguer entre chocs symétriques et chocs asymétriques. Des chocs symétriques agissent dans la même direction ou touchent les pays concernés de la même façon. A l'inverse les chocs asymétriques ont des effets contraires. Cela peut être grave dans un monde d'interdépendances. Ainsi les pays composant l'Union euroépenne peuvent encaisser différement des modifications dans les variables économiques. Par exemple l'appréciation de l'euro favorise les économies à compétitivité hors-prix comme l'Allemagne mais défavorise les pays à compétitivité-prix. Un euro surévalué pénalise à n'en pas douter un pays comme la Grèce qui mise en partie sur ses recettes touristiques. Cela questionne en tout cas la pertinence d'une politique commune au niveau européen pour des pays qui sont encore trop disparâtes. A cet égard on peut se demander à quel genre de choc serait associée la sortie d'un ou de plusieurs pays de la zone euro, si ce n'est de l'Union européenne elle-même?
Au final si on ressent bien l'utilité de la notion de choc de par les dimensions multiples auxquelles elle renvoie, on ne peut que s'interroger sur sa stabilité conceptuelle. Que cherche-t-elle à montrer en l'utilisant ? Faut-il encore la conserver dans le cadre d'un enseignement au lycée sans mise en garde particulière de surcroît impossible à effectuer vue l'étendue avérée du programme de SES en Terminale ?
La défense de l'étalon-or, un combat d'arrière-garde?
![]() Par
LONGUEPEE Daniel
Le 14/02/2011
Par
LONGUEPEE Daniel
Le 14/02/2011
De plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer le retour à l'étalon-or comme source de régulation des échanges internationaux. Robert Zoellick, président de la Banque mondiale l'a même évoqué il y a quelques temps. Reste à voir si une telle solution est souhaitable et surtout envisageable.
Le régime d'étalon-or a pour lui la force d'une construction institutionnelle où chaque monnaie est définie selon un certain poids d'or et se réfère à un taux de change fixe. Si un pays connaît des excédents extérieurs, il peut demander la conversion des devises étrangères, avec lesquelles les autres pays l'ont payé, en or. Ces derniers connaissent des sorties d'or et doivent réduire la masse monétaire afin que d'éventuelles convertibilité en or soient réalisables. Les sorties d’or sont alors le signe, pour la banque centrale, que la quantité de monnaie en circulation est trop importante. Elle doit normalement augmenter ses taux d’intérêt. La hausse des taux comprime la demande interne, la masse monétaire donc la baisse des prix, et stimule la compétitivité. Les pays importent moins, peuvent de nouveau exporter et devenir excédentaire. Le mécanisme est admirable, du moins en théorie. Mais qu’en fut-il dans les faits? Pourquoi a-t-il été finalement abandonné?
Déjà il faut souligner que le système d'étalon-or n’a jamais été concerté mais qu’il s’est diffusé progressivement au 19ème siècle—avec une apogée début 20ème—autour de la Grande-Bretagne et de sa monnaie, la livre sterling. Précisément comme le rappellent Cécile Bastidon Gilles, Jacques Brasseul et Philippe Gilles dans leur Histoire de la globalisation financière (2010), l'étalon-or apporta certes une grande stabilité dans les échanges internationaux mais il constitua davantage un étalon-sterling, c’est-à-dire que les monnaies se sont échangées par rapport à la monnaie britannique et que l’or circulait peu. Par ailleurs les dépôts bancaires (quantité de monnaie) ont augmenté bien plus vite que la quantité d’or condamnant à terme de système (multiplication par 5 des premiers entre 1885 et 1913 contre 3,5 pour l’or !). Par ailleurs il ne faut pas exagérer les vertus de l'étalon-or comme le montrent Marc Flandreau et Frédéric Zumer dans une étude de l'OCDE de 2006 sur "Les Origines de la mondialisation financière (1880-1913)”. Ainsi ce n'est pas la diffusion de l'étalon-or qui a entraîné la réduction des primes de rendement entre pays lorsqu'ils font appel à l'épargne étrangère. Comme certaines mesures forment un paquet global (financières, industrielles, ...), voir misent sur l'effet d'annonce, il est difficile de faire la part des choses. C’est notamment le cas pour le Japon. Ce dernier adopte l’étalon-or en 1897 et voit effectivement chuter sa prime de risque. Le problème c’est que l’adoption de l’étalon-or s’effectue parallèlement à l’entrée dans l’ère Meiji et son cortège de réformes dont la sécurisation des droits de propriété. Entre autres elle succède à la victoire militaire contre la Chine (et donc à l'émergence du Japon comme puissance régionale) et à l'indemnité reçue placée à Londres comme gages des futurs emprunts. Difficile alors de soutenir que l’étalon-or fut la cause unilatérale, de part la stabilité financière qu’il annonce, du taux des emprunts extérieurs du Japon.
Si les vertus de l’étalon-or doivent-être relativisées, il semble par contre que ses limites soient bien réelles et notamment le risque de déflation et de ralentissement économique qu’il laisse toujours planer. Augmenter les taux d’intérêt et freiner l’inflation pour soutenir le change risquent en effet de se traduire par moins d’activité économique et plus de chômage. Or jusqu’à quel point les agents économiques sont-ils prêts à sacrifier, comme on dit, l’équilibre interne (croissance, plein-emploi) à l’équilibre externe (stabilité du taux de change)? Voilà pourquoi Keynes a pu parler de “relique barbare” au sujet de l’étalon-or. La discipline qu’il impose n’est ni nécessaire, ni souhaitable. D’ailleurs pour Bastidon Gilles, Brasseul et Gilles (2010) ce sont "les interactions économie/politique [qui] ont fini par condamner le système", et plus largement les idées libérales qui vont de pair avec la foi dans les mécanismes auto-régulateurs de l'étalon-or. Le fait que les poussées démocratiques puisse contrevenir à l’étalon-or a été récemment réinterprété par l’économiste américain Dany Rodrik dans le cadre de son "trilemme politique de l'économie mondiale". Selon Rodrik en effet, il n'est pas possible d'avoir en même temps la démocratie, la globalisation—sous-entendue financière—et l'indépendance des politiques nationales dans le cadre des Etats-Nations. Un pays doit choisir entre 2 de ces 3 termes. Or si l'étalon-or a préservé l'indépendance des politiques nationales et la liberté des échanges il a sacrifié la démocratie et les revendications salariales entre autres. La montée de la démocratie ne pouvait que condamner l'étalon-or. Pourquoi alors souhaiter son retour? Ne veut-on pas ainsi soumettre la souverainté populaire à la souveraineté économique? Plus gravement les partisans de l'étalon-or ignorent-ils les revendications sociales?
En fait les choses ne sont pas si simples. Revenons un instant à l'économiste généralement reconnu comme le grand défenseur de l'étalon-or, à savoir Jacques Rueff. C'est justement par la discipline qu'il impose que l'étalon-or est à-même d'empêcher la plus grande menace pesant sur le monde occidental pour lui, l'inflation. Rueff n'a pas de mots assez durs envers cette dernière. « Bien plus que l'idéologie marxiste, l'inflation engendre l'esprit de classe. Par le sentiment de frustration qu'elle suscite dans la plus large partie de la population, celle qui eût du être mieux protégée, elle fait naître la volonté de subversion sociale et de révolution », (J. Rueff, 1952, p. 82). Précisément l'ordre social passe par la stabilité des prix et plus largement par le respect des droits de propriété. Dans nos économies nul ne peut demander quelque chose s'il n'a pas offert quelque chose en contrepartie. Par exemple les salariés peuvent se porter acquéreurs de biens et services parce qu'il ont vendus leur force de travail. Or l'inflation correspond précisément à une situation où grâce à une création monétaire artificielle, certains agents économiques peuvent acheter sans rien offrir en contrepartie. On voit bien alors que les agents ayant "joué le jeu" se trouvent lésés. Une partie de leurs droits de propriété se retrouvent sans valeur. D'où le sentiment de frustration évoqué par Rueff. Au niveau des échanges extérieurs, un pays ne peut durablement vivre au dessus de ses moyens. Il doit un jour ou un autre freiner sa demande interne et redevenir exportateur net à moins de voir l'or complètement disparaître. Concernant les revendications sociales et en particulier salariales, Rueff n'y est absolument pas étranger. Sa pensée se rapproche sensiblement de l'ordolibéralisme qui tente justement de concilier exigences économiques et exigences sociales. Mais il ne veut pas que l'allègement des souffrances sociales qu'occasionne le marché (perte de revenus, changement de profession, etc.) passe par un déficit créateur d'inflation. Il défend plutôt le principe de la redistribution. On voit alors qu'au delà de l'étalon-or, c'est la véracité de la monnaie que défend Rueff dans le cadre de ce qu'il appelera "le problème institutionnel de la monnaie". "Contrairement à ce que croient les profanes, il n'est, en matière monétaire, aucune orthodoxie. On peut concevoir un grand nombre de systèmes, qui se distinguent par leurs vertus propres" (Le Problème des balances de paiement, p. 181). L'étalon-or n'est ici qu'un moyen et le contexte particulier de l'Après-Seconde-Guerre-Mondiale n'a pu que renforcer cette vision. En effet pour parer aux désordres économiques de l’Entre-Deux-Guerre, les pays se sont concertées pour établir un nouveau système monétaire international lors des accords de Bretton Woods. Il fut décidé que le dollar serait convertible (35 dollars l’once d’or) et que les monnaies se définiraient par rapport au dollar dans le cadre de parités fixes (système de change-or). Le pouvoir exhorbitant accordé au dollar résultait de la place particulière les Etats-Unis : première puissance économique et premier stock d’or. La perennité du système reposait alors sur la capacité des Etats-Unis à soutenir la parité officielle du dollar dans ce faux régime d’étalon-or. Dans la mesure où les Etats-Unis ont contribué à financer la croissance mondiale, les avoirs en dollars des pays étrangers n'ont cessé d'augmenter. Ainsi le rapport "Réserves étrangères en dollars/Réserves d'or des Etats-Unis" a fini par atteindre 5 au tout début des années 70 conduisant le président américain Richard Nixon à suspendre convertibilité-or du dollar. Cette décision condamna à terme le système de Bretton Woods et plus largement la référence à l'or. Remarquons que le système d’étalon-or (“pur”) du 19ème s’est heurté à la même limite. Le secrétaire au trésor étasunien John Connally pourra alors soutenir que " le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème". D'ailleurs le dollar est resté un problème dans la mesure où les Etats-Unis ont pu continué à vivre au dessus de leurs moyens et la crise financière des subprimes a précisément résulté de ce manque de discipline interne. On a fait croire aux Américains qu'ils s'enrichissaient en s'endettant, alors que c'est exactement l'inverse. Nous ne pouvons que trop conseiller sur cette question l'ouvrage de William Bonner et Addison Wiggin publié juste avant le déclenchement de la crise, L'Empire des dettes – A l'aube d'une crise économique épique. Pire : la gestion de la crise des subprimes a entraîné un déchaînement de création monétaire, comme les 600 milliards de dollars injectés par la banque centrale américaine (la Fed) dans le cadre du quantitative easing 2. Patrick Artus et Marie-Paule Virard ont même pu titrer leur ouvrage de 2009, La Liquidité incontrôlable. Dans ce contexte il est probable que le retour à l’étalon-or entraîne une ruée vers l’or aux Etats-Unis. Et pour faire face à un tel rush la Fed serait contrainte d’augmenter ses taux et de plonger l’économie américaine dans une recession. Une telle éventualité n’est-elle pas alors le prix à payer pour les excès passés? Devons-nous refuser un système sous prétexte qu’il condamne au moins à court terme à une cure d’austérité, de toute façon inévitable? Après tout les problèmes financiers que rencontrent de nombreux pays Etats et les restrictions budgétaires qu’ils ont commencé à engendrer, ne sont-ils pas la conséquence de la gestion de la crise financière? Un jour ou l'autre il faut payer ses égarements. Le problème ici, c’est que tous les pays ne sont pas responsables des inconséquences des autres mais en subiront les effets. On cerne mieux alors les tentations protectionniste et de repli sur soi. Refusons d’importer une crise qui vint de l’extérieur. Mais ici encore, peut-être que l’étalon-or constitue une réponse plausible. Les Etats-Unis auraient-ils pu s’endetter à tort et à travers vis-àvis des Chinois par exemple sans risquer des sorties d’or? Il est évident quelque part que si les Etats-Unis avaient attendu d’être à l’équilibre vis-à-vis des Chinois, ces derniers auraient du mettre quelques années (décennies?) de plus pour s’industrialiser. Aussi pour certains, dont le provocateur Hugo Salinas Price l’étalon-or constituerait-il le meilleur moyen pour ré-industrialiser les Etats-Unis. Les américains seraient obligés de produire chez eux ce qu’ils importent actuellement. Toutefois cela ne se fera t-il pas au prix d’une baisse drastique du pouvoir d’achat? Comment la population acceptera t-elle de payer un écran plat 50% plus chèr? Aussi la réflexion doit-elle être encore plus globale et engager le régime de croissance lui-même. A quoi bon finalement toute cette profusion de biens à bas prix? Après tout la richesse crée plus de frustration que de jouissance. Les défauts de l’étalon-or pourraient alors militer pour sa défense ...
Ces théories de la croissance qui n'ont pas besoin d'institutions
![]() Par
LONGUEPEE Daniel
Le 11/01/2011
Par
LONGUEPEE Daniel
Le 11/01/2011
Il a tellement été prétendu que l'économie était devenue institutionnelle que les économistes qui suivent la voie inverse ne peuvent que susciter un minimum de curiosité et d'intérêt. Ce genre d'approches peut alors se qualifier d'"a-institutionnel" dans la mesure où il n'accorde aucune place privilégiée aux institutions c'est-à-dire aux comportements, aux façons de penser et d'agir (idéologie), aux contraintes juridiques, etc. Trois économistes illustrent bien cette perspective : Jeffrey Sachs, Oded Galor et Gregory Clark. Tous trois se sont intéressés aux facteurs de la croissance et aux retards de développement à l'échelle mondiale.
Sachs et ses collaborateurs sont entrés dans la querelle du "institutions don't matter" (les institutions ne sont pas importantes"), titre d'un article de Sachs, qui met plutôt en avant l'importance de la géographie pour expliquer le sous-développement de certaines zones. L'Afrique sub-saharienne constitue un exemple éclairant dans la mesure où son climat est très favorable à la propagation d'un certain type de moustique, l'anophèle, vecteur du paludisme. Or cette maladie a des conséquences extrêmement graves et importantes sur l'état physique de la population, et par voie de conséquence sur sa productivité. L'équipe autour de Sachs a même élaboré un indicateur d'intensité du paludisme indépendant des conditions économiques et sociales pour bien s'assurer du sens de la causalité. Ce n'est pas parce que la population est initialement pauvre qu'elle ne parvient pas à lutter contre le paludisme mais bien plutôt à cause du paludisme qu'elle n'a pu croître comme les autres zones géographiques. Par conséquent tout le discours sur la bonne gouvernance institutionnelle mise au point par le FMI ou la Banque mondiale paraît hors de propos au sujet de l'Afrique sub-saharienne. A quoi bon par exemple l'indépendance des banques centrales censée éviter les collusions politiques? Cette zone a avant tout besoin d'une aide financière massive pour éradiquer le paludisme, à l'instar du programme "Roll back malaria" ou de la Fondation Bill et Melissa Gates. Dans l'immédiat il s'agit de généraliser l'usage des moustiquaire et à plus long terme de trouver un vaccin.
Les analyses de Galor et Clark se distinguent de la précédente en se fondant sur la théorie de l'évolution et de la sélection naturelle pour expliquer la croissance à long terme. Au coeur du principe de la sélection naturelle, il y a l'idée de l'économiste anglais Thomas Malthus (1766-1834) selon laquelle la population croît de manière arithmétique (comme une suite du type n+1 : 1, 2, 3, 4, ...) et les subsistances de manière géométrique (comme une suite du type 2n : 1, 2, 4, 8, ...). Il arrive un moment où la population excède la quantité de subsistances et où une partie de cette population est immanquablement amenée à disparaître et en particulier les classes inférieures, les plus faibles. Comme le prétend Malthus : "Un homme qui est né dans un monde déjà occupé (…) n'a aucun droit de réclamer la moindre nourriture et, en réalité, il est de trop. Au grand banquet de la nature, il n'y a point de couvert disponible pour lui; elle lui ordonne de s'en aller, et elle ne tardera pas elle-même à mettre son ordre à exécution." Ce principe peut ensuite se généraliser à l'ensemble des espèces vivant sur Terre. Ainsi la rareté des ressources fait que seuls les comportements adaptés au milieu ont des chances de se reproduire. Puisqu'il y a en général plus de descendance que de ressources disponibles, seule une partie de cette descendance pourra survivre et se reproduire. Petit à petit se dégagent donc des communautés dont les traits en constante évolution résultent de la lutte pour la vie. Nous sommes en plein dans la théorie de la sélection naturelle.
En ce qui concerne l'espèce humaine, Galor et Clark reprennent précisément l'idée d'un verrou malthusien qui aurait maintenu l'Humanité au seuil de subsistance jusqu'aux environs de la Révolution industrielle anglaise. Pendant tout ce temps les gains de productivité étaient compensés par une augmentation équivalente de la population venant buter sur la limite des ressources disponibles. Les phases de croissance ne débouchaient sur aucune amélioration du niveau de vie. Et la Révolution industrielle marque précisément le passage à un régime de croissance soutenue permettant d'élever durablement et jusqu'ici de manière irréversible le niveau de vie des populations. Toutefois, bien que cherchant à expliquer cette exceptionnelle cassure du 18-19ème siècle en terme de produit par tête, Galor et Clark ne vont pas retenir le même opérateur de base.
Pour Galor ce sont les stratégies reproductives des populations humaines qui constituent la clef de lecture de l'histoire économique. La croissance soutenue est associée au passage d'une stratégie quantitative à une stratégie qualitative. Cette lecture binaire empruntée aux sciences naturelles indique que les couples qui, a un moment donné, ont fait le choix de faire moins d'enfants mais de mieux s'en occuper, ont eu un avantage sélectif sur les autres. Des enfants mieux éduqués ont en effet pu développer des facultés en phase avec les impératifs d'une croissance soutenue. De tels comportements ont alors eu toute vocation à se propager dans la société.
Pressions évolutionnistes => Généralisation de la stratégie « qualitative » => Population plus qualifiée => Progrès technique envisageable possible.
L'idée selon laquelle la population est susceptible de jouer sur la croissance n'a pas de quoi surprendre puisque qu'après tout, le travail constitue bien un facteur de production. En tout cas Galor qualifie de théorie unifiée de la croissance son approche puisqu’elle est fondée sur un principe unique et travers l’histoire économique.
Clark dénigre explicitement le rôle des stratégies différentielles de reproduction et déplace l'action des forces évolutionnistes au niveau des gènes. De toute façon passer par exemple de 2 à 10 enfants ne modifie la richesse des fils que de 25% selon lui. En fait, à un moment donné de l'histoire la sélection des plus aptes s'est confondue avec la sélection des plus riches (“the survival of the richest” écho du célèbre “survival of the fittest”). Ces derniers ont disposé d'une plus grande descendance viable dont les membres ont innondé l'ensemble de la société et avec eux leurs comportements spécifiques associés à un ensemble de gènes. “Toutes les sociétés malthusiennes, comme l’a reconnu Darwin, sont intrinséquement modelé par la survie du plus apte. Elles récompensent certains comportements aux succès reproductif et ces comportements deviennent la norme de la société” (A Farewell to Alms, p. 186). Ainsi les comportements violents, agressifs, impulsifs associés aux sociétés primitives et traditionnelles auraient vus leurs vertus reproductives s’effacer dès le Moyen-Âge au profit de comportements pacifiés et réfléchis liés au travail, à l’effort, à l’épargne. Les industrieux finissent par être courtisés au détriment des guerriers. Le problème dans ce raisonnement c'est qu'il convoque la biologie (les gènes) alors même que le processus pourrait demeurer culturel. D'ailleurs Clark ne le nie pas et recours aux deux types d'explications tout en accordant sa préférence à la première, la plus novatrice sans doute. Il est évident en tout cas que l'idée de transformation progressive des normes de comportements n'est pas nouvelle et rappelle au minimum les travaux du sociologue allemand Norbert Elias sur le "Procès de civilisation". Mais cette dimension culturelle au coeur de l'analyse ne constitue-t-elle pas une porte d'entrée pour la théorie institutionnelle dans la mesure où les normes de comportements relèvent des institutions informelles? Clark s'en sort uniquement en ramenant les institutions à leur versant formel sous forme de de lois, réglements, etc. Ne pouvons alors considérer qu'il est difficile de s'abstraire du cadre institutionnel des relations humaines et l'appliquer à l'ensemble des approches abordées précédemment ? En fait les modèles de Sachs ou de Galor évoqués avant ne nient pas tout rôle aux institutions. Par exemple l'acheminement des fonds de lutte contre le paludisme est facilitée par des gouvernements non corrompus. Simplement, lutter contre la corruption n'est pas une condition nécessaire et suffisante à l'instauration d'une croissance durable. De même en avouant que son modèle unifiée de croissance constitue une approche globale (une boîte noire), Galor n'écarte pas tout rôle amplificateur ou modérateur au cadre institutionnel, sans que ce dernier ne remette en cause la trame évolutionniste.
Pour conclure disons que le problème des théories de la croissance et du développement, c’est qu’elles sont toutes séduisantes, voir reposent sur les mêmes genre de tests économétriques. Comment alors faire son choix? Par exemple après avoir lu Le Mystère du capital de Fernando de Soto, on ne peut être que convaincu par la thèse institutionnelle. Sans règles juridiques le capital semble bien demeurer du capital mort incapable de se multiplier et les richesses rester en sommeil à l’état latent. Comment en effet développer des ressources si nul ne jouit d’aucun titre de propriété et que les bénéfices ne peuvent légitimement et légalement être appropriés? Les institutions comme l’instauration d’un cadastre, les règles juridiques, etc. constituent un véritable facteur de production. Mais une fois que l’on a fermé l’ouvrage et que l’on se met à lire un article de Sachs ou de Galor, on est alors persuadé que la géographie a effectivement un rôle à jouer, que la croissance actuelle résulte de comportements passés dans un cadre évolutionniste. Pourrons-nous alors résoudre un jour le "mystère du capital"?